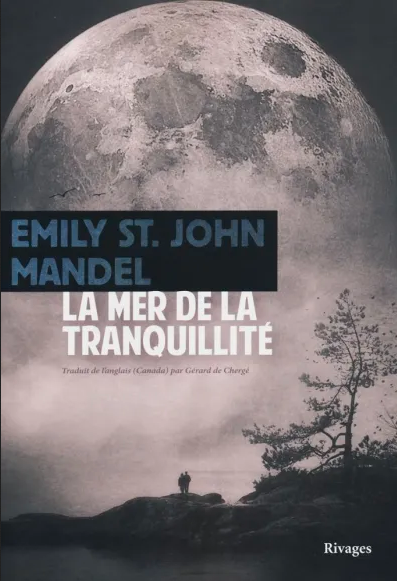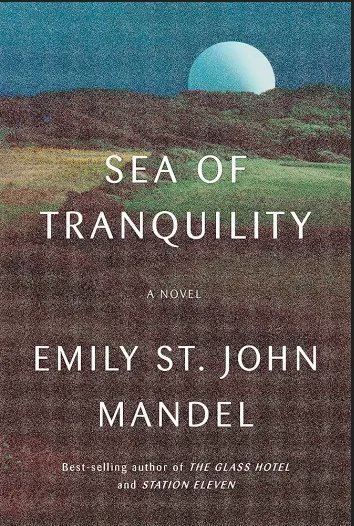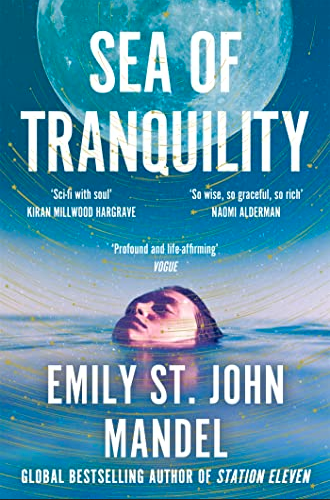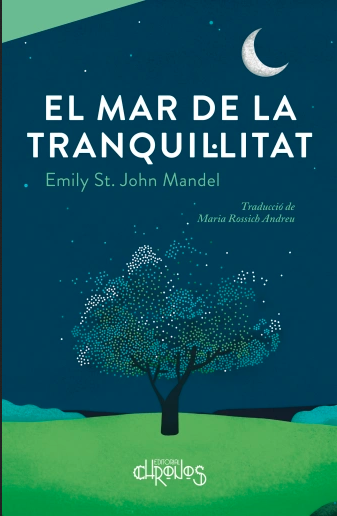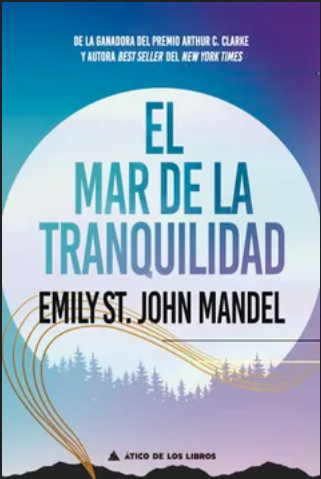Hein ? (tranquillité de la mer) d'Emily St-John Mandel
Quatre époques, un réseau de résonances et de correspondances mystérieuses, des anomalies dont le sens se dérobe à travers la toile du temps : une formidable spéculation, poétique et romanesque, joueuse et sérieuse, sur les natures de la réalité, entre physique et perception intime.
Edwin St. John Andrew, dix-huit ans, traîne le poids de son nom doublement sanctifié à bord du bateau à vapeur qui traverse l’Atlantique. Les yeux plissés contre le vent qui souffle sur le pont supérieur, il se cramponne au bastingage de ses mains gantées, impatient d’avoir un aperçu de l’inconnu, s’efforçant de discerner quelque chose – quoi que ce soit ! – au-delà de la mer et du ciel, mais il ne voit que des dégradés de gris sans fin. Il est en route vers un monde différent. Il se trouve plus ou moins à mi-chemin entre l’Angleterre et le Canada. J’ai été envoyé en exil, se dit-il, conscient d’être mélodramatique, même s’il y a un fond de vérité dans cette formule.
Edwin compte parmi ses ancêtres Guillaume le Conquérant. Lorsque son grand-père mourra, son père deviendra comte, et Edwin a fait ses études dans deux des meilleures écoles du pays. Cependant, il n’a jamais eu un grand avenir en Angleterre. Il existe bien peu de professions que peut exercer un gentleman, et aucune d’elles n’intéresse Edwin. La propriété familiale étant destinée à son frère aîné, Gilbert, il risque de n’hériter de rien. (Le frère cadet, Niall, est déjà en Australie.) Edwin aurait pu s’accrocher à l’Angleterre un peu plus longtemps, mais il nourrit secrètement des vues révolutionnaires qui sont apparues de manière inattendue au cours d’un dîner, précipitant son destin.
Dans un élan d’optimisme extravagant, Edwin s’est inscrit comme « fermier » sur le manifeste du navire. Il lui vient plus tard à l’esprit, lors d’un moment de contemplation sur le pont, qu’il n’a jamais touché ne serait-ce qu’une bêche.
Edwin, en 1912, rejeton d’une noble famille britannique, est en voie accélérée de déclassement, du fait de son rang de naissance dans la fratrie, aggravé d’opinions socio-politiques visiblement alors malséantes. L’exil apathique vers le Canada est une voie de garage toute trouvée, jusqu’à ce qu’un phénomène étonnant ne semble venir s’interposer, en un lieu de Colombie-Britannique déjà fréquenté dans de tout autres circonstances par les lectrices ou les lecteurs de l’ouvrage précédent d’Emily St. John Mandel, « L’hôtel de verre » (2020).
Mirella, en 2020, était une amie de Vincent Alkaitis, la principale protagoniste de « L’hôtel de verre », justement. Après lui en avoir voulu à mort, supposant qu’elle ne pouvait pas avoir ignoré les malversations tragiques de son époux, elle s’est mise à douter après avoir appris sa disparition, et tente d’approcher son frère, musicien, pour trouver, peut-être, quelques réponses et de l’apaisement.
Olive, en 2203, est une romancière native de la Colonie Lunaire de la Terre. Loin de sa famille restée sur le satellite, en pleine tournée promotionnelle au long cours pour son roman « Marienbad », qui traite notamment d’une pandémie de grippe mortelle (on se souviendra bien entendu que c’était là l’une des prémisses du « Station Eleven » post-apocalyptique – mais pas que, loin de là – d’Emily St. John Mandel en 2013), elle réalise peut-être trop tard, manquant un certain nombre de signes annonciateurs du fait du tourbillon propre aux tournées du monde des lettres, qu’elle est elle-même prise au sein d’un phénomène dangereux en cours de montée en puissance.
Deux siècles plus tard, Gaspery-Jacques, en 2401, porte le nom d’un personnage créé par Olive Llewellyn dans « Marienbad ». Il exerce le métier de responsable de la sécurité pour un hôtel de la colonie lunaire, et porte en conséquence un chapeau de type fédora (en beau clin d’œil à l’iconographie traditionnelle du hard boiled noir, mais surtout sans doute au Josephus Miller de « The Expanse » apparu en 2011 sous le clavier du duo James S.A. Corey). Il se retrouve néanmoins recruté par l’Agence Temporelle pour laquelle travaille sa brillantissime physicienne de sœur, et, après plusieurs années d’entraînement, se voit chargé de l’investigation sur « le terrain » (le passé, donc) d’une anomalie troublante du tissu temporel, dont plusieurs des personnages présentés auparavant dans le roman semblent avoir été, consciemment ou non, les témoins.
Comment relier ces points apparemment épars sur la carte du temps et leur donner tout leur sens possible ? C’est le défi que propose et relève avec un extrême brio cette « Mer de la Tranquillité ».
Et si, au lieu de cela, on voulait disparaître dans ladite nature ? Étrange pensée à bord d’un bateau qui fait route vers le nord, une semaine plus tard, remontant la côte ouest découpée de l’île de Vancouver. Un paysage de plages irrégulières et de forêts, avec des montagnes en toile de fond. Et puis d’un seul coup, aux rochers déchiquetés succède une plage de sable blanc, la plus longue qu’Edwin ait jamais contemplée. Il voit des villages sur le rivage, des volutes de fumée, des poteaux en bois ornés d’ailes et de visages peints – des totems, se souvient-il – érigés çà et là. Il n’en comprend pas la signification et les trouve donc menaçants. Au bout d’un long moment, le sable blanc disparaît et le rivage redevient un mélange de rochers escarpés et de criques. De temps à autre, il aperçoit au loin un canoë. Et si on devait se dissoudre dans la nature sauvage comme le sel dans l’eau ? Edwin veut rentrer chez lui. Pour la première fois, il commence à s’inquiéter pour sa santé mentale.
Les passagers du bateau : trois Chinois allant travailler à la conserverie ; une jeune femme très nerveuse, d’origine norvégienne, qui voyage pour rejoindre son mari ; Thomas et Edwin ; le capitaine et deux hommes d’équipage canadiens, sans compter des tonneaux et des sacs de fournitures. Les Chinois rient et parlent dans leur langue. La Norvégienne reste dans sa cabine, sauf pour les repas, et ne sourit jamais. Le capitaine et les matelots sont cordiaux, mais ça ne les intéresse pas de bavarder avec Thomas et Edwin, si bien que les deux garçons passent le plus clair de leur temps ensemble sur le pont.
« À Victoria, dit Thomas, ce que ces types totalement amorphes ne comprennent pas, c’est que ce territoire entier est là pour qu’on le prenne. » Edwin lui jette un regard en coin et voit dans l’avenir : Thomas ayant été rejeté par la communauté des affaires de Victoria, il passera le restant de ses jours à pester contre eux. « Ils sont engoncés dans leur petite ville bien anglaise et… bon, je comprends que ça puisse séduire, mais nous avons ici des opportunités à saisir. Nous pouvons créer en ce lieu notre propre monde. » Il continue à palabrer sur l’Empire et sur les opportunités pendant qu’Edwin regarde au-delà de l’eau. Les goulets, les criques et les petites îles sont à tribord ; à l’arrière-plan se dresse l’immensité de l’île de Vancouver, avec ses forêts grimpant à flanc de montagnes dont les sommets se perdent dans les nuages bas. Du côté babord, où ils se tiennent, l’océan s’étend sans interruption jusqu’à la côte du Japon – pour autant qu’Edwin puisse l’imaginer. Il éprouve le même sentiment nauséeux de surexposition qu’il a ressenti dans la prairie. C’est un soulagement quand le bateau effectue enfin un lent virage à droite et s’engage dans un goulet.
Ils atteignent le village de Caiette en début de soirée. Celui-ci se compose de peu de chose : un débarcadère, une petite église blanche, sept ou huit maisons, une route rudimentaire qui mène à la conserverie et au chantier forestier. Edwin reste planté à côté du débarcadère, sa malle à ses pieds, désemparé. Cet endroit est précaire, il n’y a pas d’autre mot. C’est une ébauche de civilisation des plus sommaires, coincée entre la forêt et la mer. Sa place n’est pas ici.
« Le bâtiment plus grand, là-bas, est une pension de famille, lui dit le capitaine avec bienveillance, si jamais vous voulez séjourner un peu ici, le temps de trouver vos marques. »
Edwin est troublé de constater que son désarroi est tellement flagrant. Thomas et lui grimpent ensemble la côte jusqu’à la pension et réservent des chambres à l’étage. Dans la matinée, Thomas part pour le camp de bûcherons tandis qu’Edwin retombe dans l’état végétatif qui s’était emparé de lui à Halifax. Ce n’est pas tout à fait de l’apathie. Il procède à un méticuleux inventaire de ses pensées et en conclut qu’il n’est pas malheureux. Il désire simplement ne plus avoir à bouger dans l’immédiat. S’il y a du plaisir dans l’action, il y a de la paix dans la passivité. Il passe ses journées à se promener sur la plage, à dessiner, à contempler la mer depuis la véranda, à lire, à jouer aux échecs avec d’autres pensionnaires. Au bout d’une semaine ou deux, Thomas renonce à essayer de le persuader de l’accompagner au camp.
Edwin est fasciné par la beauté du lieu. Il aime rester assis sur la plage à regarder au loin les îles, petites touffes d’arbres émergeant de l’eau. Des canoës passent de temps à autre, pour des missions inconnues, et leurs passagers – hommes et femmes – tantôt l’ignorent, tantôt le dévisagent avec curiosité. Des bateaux plus grands arrivent à intervalles réguliers, amenant des hommes et des fournitures pour la conserverie et le chantier. Certains d’entre eux savent jouer aux échecs, ce qui est l’un des grands plaisirs d’Edwin. Il n’a jamais été très doué pour ce jeu, mais il apprécie le sens de l’ordre qui y préside.
« Qu’est-ce que vous faites ici ? lui demande-t-on parfois.
– Oh, je réfléchis à ma prochaine étape », répond-il toujours, ou une formule similaire. Il a le sentiment d’attendre quelque chose. Mais quoi ?
Dès ses trois premiers romans (« Dernière nuit à Montréal » en 2009, « On ne joue pas avec la mort » en 2010 et « Les variations Sebastian » en 2012), officieusement classés dans le policier ou le roman noir, la Canadienne Emily St. John Mandel nous avait impressionné par sa capacité rare à s’affranchir, justement, de ces frontières entre genres littéraires souvent si artificielles, quand elles ne ressortent pas purement du marketing simplifié. Trois thrillers inclassables, trois romans policiers hautement inhabituels, trois démonstrations de composition créative, où l’agencement des mémoires et des non-dits provoque une sensation finalement unique, entre satisfaction intellectuelle, ironie suprême du sort et mélancolie du troisième type.
« Station Eleven », en 2013, en s’inscrivant en apparence dans une grande partie des codes de la science-fiction post-apocalyptique pour mieux les détourner poétiquement, et « L’hôtel de verre », en 2020, confrontant le thriller financier réimaginé de l’affaire Madoff et le fantastique discret des destins croisés, nous ont montré avec un grand bonheur que, quel que soit le thème apparent de ses romans, Emily St. John Mandel poursuit des objectifs poétiques bien personnels, toujours joyeusement indéchiffrables dans un premier temps, pour lesquels la position initiale des pièces sur l’échiquier romanesque est presque toujours trompeuse et vouée à déjouer les attentes de la lectrice ou du lecteur.
On ne se lasse décidément pas, bien au contraire, de ce machiavélisme mélancolique, dont « La Mer de la Tranquillité », sixième roman publié en 2022 et traduit en 2023 par Gérard de Chergé chez Rivages, endossant les habits science-fictifs du voyage dans le temps et des simulations indémontrables (Philip K. Dick, Daniel Galouye, Rainer Werner Fassbinder et même Mika Biermann ne sont donc potentiellement pas si éloignés), nous en offre une nouvelle démonstration éblouissante.
« Je voudrais vous montrer quelque chose d’étrange. » Le compositeur – qui a été célèbre dans un cercle extrêmement restreint, une sorte de niche, c’est-à-dire qu’il ne courait aucun danger d’être reconnu dans la rue mais que la plupart des gens appartenant à une ou deux sous-cultures artistiques confidentielles connaissaient son nom – était manifestement mal à l’aise. Il se pencha tout près de son micro, le visage en sueur. « Ma sœur avait l’habitude d’enregistrer des vidéos. Celle-ci, que j’ai trouvée dans ses affaires après sa mort, présente une espèce d’anomalie que je n’arrive pas à expliquer. » Il s’interrompit, occupé à régler un bouton sur son clavier. « J’ai écrit une musique pour l’accompagner, mais le morceau s’arrêtera juste avant l’anomalie pour nous permettre d’apprécier la beauté de l’imperfection technique. La musique se fit d’abord entendre, crescendo de cordes à la tonalité rêveuse, suggestion de parasites affleurant sous la surface, puis vint la vidéo : sa sœur promenait sa caméra le long d’un sentier forestier à peine marqué, en direction d’un érable très ancien. Elle passait sous les branches de l’arbre et braquait sa caméra vers le haut, dans le feuillage vert qui étincelait au soleil, caressé par la brise, et la musique s’interrompit si brusquement que le silence fit l’effet d’être la mesure suivante. Celle d’après fut l’obscurité : l’écran vira au noir pendant une seconde, il y eut une brève confusion de sons qui se chevauchaient – quelques notes de violon, une lointaine cacophonie comme à l’intérieur d’une station de métro, un étrange whoosh évoquant une pression hydraulique – et puis en un clin d’œil ce fut terminé, l’arbre était de nouveau là et la caméra faisait des mouvements chaotiques tandis que la sœur du compositeur, semblait-il, regardait autour d’elle avec affolement, oubliant peut-être la caméra qu’elle avait à la main.
La musique du compositeur reprit, passant en douceur à l’une de ses compositions les plus récentes, laquelle accompagnait cette fois une vidéo qu’il avait tournée lui-même, cinq ou six minutes d’un coin de rue de Toronto d’une laideur agressive, mais avec un orchestre à cordes s’efforçant laborieusement de rendre l’idée d’une beauté cachée. Le compositeur travaillait rapidement, jouant sur ses claviers des séquences de notes qui, une mesure plus tard, émergeaient sous forme d’accords de violon, construisant la musique par couches successives tandis que défilaient sur l’écran, au=dessus de sa tête, les images de la rue de Toronto.
Au premier rang des spectateurs, Mireille Kessler était en larmes. Elle avait été amie avec Vincent, la sœur du compositeur, et n’avait pas su que celle-ci était morte. Elle quitta la salle peu après et passa quelque temps dans les toilettes pour dames, essayant de se ressaisir. Profondes inspirations, couche de maquillage réparatrice. « Du calme, dit-elle tout haut à son reflet dans le miroir. Du calme. »
Elle était venue à ce concert dans l’espoir de parler au compositeur et de découvrir où se trouvait Vincent. Elle avait certaines questions qu’elle aurait voulu poser. Parce que, dans une version de sa vie si lointaine qu’elle s’apparentait aujourd’hui à un conte de fées, Mirella avait eu un mari – Fayçal – et tous deux avaient été amis avec Vincent et le mari de cette dernière, Jonathan. Il y avait eu plusieurs années magnifiques, des années de voyages et d’argent, et puis les lumières s’étaient éteintes. Le fonds d’investissement de Jonathan s’était révélé être une pyramide de Ponzi. Fayçal, incapable de faire face à la ruine financière, s’était donné la mort.
Par la suite, Mirella n’avait plus jamais parlé à Vincent, car comment celle-ci aurait-elle pu ne pas être au courant ? Cependant, une décennie après le suicide de Fayçal, elle se trouvait au restaurant avec Louisa, sa petite amie depuis un an, quand le premier doute s’était insinué en elle.
Marcel Theroux, dans The Guardian (ici), notait (en substance) le talent rare de l’autrice pour connecter les traces, les échos distants, les résonances infra-sensibles de faits et de sensations apparemment éloignées ou purement coïncidentes. Laird Hunt, dans The New York Times (ici), admire le sens de l’empathie et de l’intime qu’Emily St. John Mandel parvient à faire percoler presque à chaque instant dans un roman aussi spéculatif quant aux contenus respectifs de la réalité et de l’imagination. Maureen Corrigan, pour la National Public Radio américaine (ici), souligne la profondeur immersive avec laquelle l’autrice nous fait partager ses univers distincts et néanmoins subtilement interconnectés, « dans l’œil de la catastrophe ».
Comme beaucoup d’autres critiques le signalent également, ce qui aura frappé la plupart des lectrices et des lecteurs, c’est sans doute – parmi plusieurs autres facettes subtiles de son travail -, la manière dont Emily St. John Mandel joue avec grâce du matériau profus dont elle dispose désormais (les échos liés à ses propres œuvres et à ses lectures et visionnages abondants, tous genres confondus, sont devenus plus denses et pourtant plus subtils que jamais). Diaboliquement habile pour suggérer les doubles-fonds et les faux-semblants qui habitent ses univers comme le nôtre, elle pratique résolument une forme bien à elle de jeu sérieux, de spéculation presque métaphysique pourtant pleinement ancrée dans le matériel et dans l’intime.
Au Cap, Olive rencontra un romancier qui était sur les routes depuis un an et demi, avec son mari, pour assurer le service après-vente d’un livre qui s’était vendu quatre ou cinq fois plus que Marienbad.
« Nous essayons de voir combien de temps nous pouvons voyager avant d’être obligés de rentrer à la maison. » L’auteur se prénommait Ibby, diminutif d’Ibrahim, et son mari s’appelait Jack. Ils étaient assis tous les trois, un soir, sur le toit en terrasse de l’hôtel, encombré d’écrivains qui participaient à un festival littéraire.
« Vous cherchez à retarder le moment du retour ? demanda Olive. Ou vous aimez simplement voyager ?
– Les deux, répondit Jack. Ça me plaît d’être sur la route.
– Et notre appartement est assez loche, dit Ibby, mais nous n’avons pas encore décidé ce que nous allonrs faire. Déménager ? Rénover ? L’un ou l’autre. »
Il y avait des dizaines d’arbres sur le toit, dans d’énormes jardinières, avec de petites lumières qui scintillaient dans les branches. On entendait de la musique, un quatuor à cordes. Olive portait sa robe de designer ultrachic, une robe en lamé d’argent qui lui tombait aux chevilles. Ça, c’est l’un des moments glamour, se dit-elle, le mémorisant soigneusement afin de pouvoir y puiser plus tard de quoi se régénérer. La brise diffusait un parfum de jasmin.
« Moi, dit Jack, j’ai entendu une bonne nouvelle aujourd’hui.
– Dis-moi, le pressa Ibby. J’ai passé toute la journée dans une espèce de tunnel festivalier. Blocus sur les nouvelles de l’extérieur.
– La construction vient de commencer sur la première des Colonies Lointaines. »
Olive sourit et faillit parler, mais se trouva provisoirement à court de mots. Les plans pour les Colonies Lointaines avaient débuté quand ses grands-parents étaient enfants. Elle se souviendrait toujours de cet instant précis, pensa-t-elle, de cette réception, de ces gens qu’elle aimait beaucoup et ne reverrait peut-être jamais. Elle serait en mesure de raconter à Sylvie où elle se trouvait exactement quand elle avait appris la nouvelle. Depuis combien de temps n’avait-elle pas éprouvé un authentique émerveillement ? Cela remontait à un moment. Elle fut inondée de bonheur.
« À Alpha du centaure ! » dit-elle en levant son verre.
À Buenos Aires, Olive rencontra une lectrice qui tenait absolument à lui montrer son tatouage. « J’espère que vous ne trouverez pas ça bizarre », dit la femme en remontant sa manche pour révéler sur son épaule gauche une citation du livre – Nous savions que ça allait arriver – tracée d’une belle écriture cursive.
Olive en eut le souffle coupé. Ce n’était pas simplement une réplique de Marienbad, c’était un tatouage qui figurait dans Marienbad. Dans la seconde moitié du roman, son personnage Gaspery-Jacques avait cette phrase tatouée sur le bras gauche. Vous écrivez un livre avec un tatouage fictif et voilà que celui-ci prend corps dans la réalité ; après ça, presque tout semble possible. Elle avait déjà vu cinq tatouages semblables, mais c’était toujours aussi extraordinaire d’observer comment la fiction pouvait déteindre sur le monde et laisser une marque sur la peau de quelqu’un.
– C’est incroyable, dit-elle dans un murmure. C’est incroyable de voir ce tatouage dans le monde réel.
– C’est la phrase de votre livre que j’ai préférée, dit la femme. Elle est vraie dans tellement de domaines, n’est-ce pas ?
Mais est-ce que tout ne paraît pas évident avec le recul ? Dans le dirigeable qui planait à basse altitude vers la République du Dakota, Olive regardait par le hublot le crépuscule bleuté sur les prairies, essayant de trouver une certaine paix dans le paysage. Elle avait reçu une nouvelle invitation pour un festival sur Titan. Elle n’y était pas retournée depuis son enfance et n’en gardait que le vague souvenir du delphinarium bondé, d’un pop-corn curieusement sans saveur, de la brume jaunâtre du ciel diurne – elle était allée dans une colonie dite Réaliste, l’un des avant-postes où les colons avaient opté pour des dômes transparents afin d’expérimenter les véritables couleurs de l’atmosphère titanienne – et aussi le souvenir de pratiques étranges du genre de celle qui consistait pour les ados à peindre sur leurs visages des grands carrés de couleur semblables à des pixels, qui étaient censés déjouer les logiciels de reconnaissance faciale mais qui présentaient l’inconvénient de les faire ressembler à des clowns dérangés. Devait-elle aller sur Titan ? Je veux rentrer à la maison. Où était Sylvie en cet instant ? C’est quand même plus facile que d’avoir un emploi de bureau, ne l’oublie pas.
Il est particulièrement agréable d’être ainsi à nouveau conquis par l’autrice, et de s’immerger dans une oeuvre aussi évolutive, sûre de ses forces et de ses constantes, curieuse en diable de ses explorations et de ses variables. C’est bien ainsi, dans la quête intense d’une résonance poétique permanente, interne et externe, que s’élabore la grande fiction spéculative dont « La Mer de la Tranquillité » offre une illustration quasiment centrale.
Jamais plus à la Cité de la Nuit. Cette phrase avait un rythme qui me plaisait, si bien qu’elle se logea dans ma tête. J’y pensai souvent au cours de ma première semaine de travail, car celui-ci était d’un ennui motel. L’hôtel ayant des prétentions rétro, je portais un costume coupé dans un style antédiluvien et un chapeau d’une forme insolite appelé fédora. J’arpentais les couloirs et montais la garde dans le hall. J’étais attentif à tout et à tous, conformément aux instructions. J’ai toujours pris plaisir à observer les autres, mais les clients d’hôtels se révélaient étonnamment inintéressants. Ils arrivaient et ils repartaient. Ils apparaissaient dans le hall à des heures improbables, réclamant du café. Ils étaient ivres, ou ils étaient sobres. C’était des hommes d’affaires, ou alors ils étaient en vacances avec leur famille. Ils étaient éreintés par leurs voyages. Certains essayaient d’introduire en douce des chiens. Les six premiers mois, je ne dus alerter la police qu’une seule fois, après avoir entendu une femme hurler dans l’une des chambres de l’hôtel, et ce ne fut même pas moi qui passai l’appel : j’allai trouver le manager de nuit, qui appela la police à ma place. Je n’étais pas présent quand la femme fut emportée sur une civière par les urgentistes.
Le job était tranquille. Mon esprit vagabondait. Jamais à la Cité de la Nuit. Quelle avait été la vie de Talia là-bas ? Pas formidable à l’évidence, n’importe quel imbécile pouvait s’en rendre compte. Certaines familles sont meilleures que d’autres. Quand la sienne avait quitté la maison d’Olive Llewellyn, une autre avait emménagé, mais je n’arrivais pas à me souvenir de cette nouvelle famille en dehors d’une impression générale de déréliction. À l’hôtel, je ne voyais Talia qu’épisodiquement, traversant le hall quand elle rentrait chez elle après le travail.
À cette époque, j’habitais un petit appartement terne situé dans un bloc de petits appartements ternes à l’extrême bout de Colonie Un, si près du Périphérique que le dôme frôlait presque le toit du complexe résidentiel. Parfois, quand il faisait nuit noire, j’aimais à traverser la rue jusqu’à la route périphérique pour regarder, à travers le verre composite, les lumières de Colonie Deux qui scintillaient au loin. Ma vie, en ce temps-là, était aussi terne et étriquée que mon appartement. J’essayais de ne pas trop penser à ma mère. Je dormais toute la journée. Mon chat me réveillait en fin d’après-midi. Au coucher du soleil, j’avalais un repas qu’on pouvait raisonnablement considérer comme un dîner ou comme un petit déjeuner, j’endossais mon uniforme et me rendais à l’hôtel pour observer des gens sept heures durant.
Je travaillais depuis environ six mois lorsque ma sœur eut trente-sept ans. Zoey était physicienne à l’université et son domaine d’expertise avait un rapport avec la technologie quantique de la blockchain, concept que je n’avais jamais été capable de comprendre malgré les efforts louables de ma sœur pour me l’expliquer à plusieurs reprises. Je l’appelai pour lui souhaiter un bon anniversaire et je m’aperçus, juste avant qu’elle décroche, que je ne l’avais pas félicitée pour sa titularisation. Qui remontait à quand ? Un mois ? Je ressentis une variété familière de culpabilité.
« Joyeux anniversaire, lui dis-je. Et félicitations, aussi.
– Merci, Gaspery. » Elle ne s’appesantissait jamais sur mes manquements, et je n’arrivais pas tout à fait à analyser pourquoi cela me donnait le sentiment d’être si lamentable. Il y a une douleur sourde, spécifique, à devoir accepter le fait que tolérer vos défauts requiert une certaine générosité d’esprit chez les êtres que vous aimez.
Hugues Charybde , le 24/09/2023
Emily St John Mandel - La Mer de la Tranquillité - éditions Rivages
L’acheter ici
Emily St John Mandel