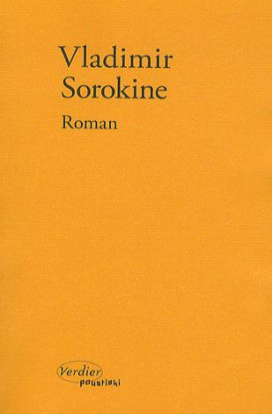Vladimir Sorokine : sortie de torpeur russe, en forme de Roman
Le (très) violent et (très) inattendu dynamitage de la mythique stase, campagnarde russe ou autre.
Le village, ou plutôt le hameau de la Roide-Combe figurait déjà dans la chronique où le hiéromoine Méthode, du monastère de l’Intercession de la Vierge, mort au début du XVIIe siècle, évoquait les troupes d’Ivan le Terrible, déployées pour la campagne de Kazan ; en l’an de grâce 1552, elles étaient stationnées, à l’en croire, près du « lieu-dit de la Roide-Combe ». Ces lignes de l’homme de Dieu, Roman les avait maintes fois relues dans la copie qu’en avait faite le père d’oncle Anton, d’après un grimoire, affirmait-il, impossible à soulever, relié de fer et orné des images de deux saints du monastère de l’Intercession, les starets Alexis et Agrippa.
Tout jeune encore, se promenant au bord du ravin, Roman laissait libre cours à son imagination, et celle-ci lui peignait des tableaux hauts en couleurs : les troupes d’Ivan cantonnées à l’entour ; une douzaine de pauvres isbas au toit de chaume ; des chevaux sans selle, qui, dans le vacarme, les hennissements, les grincements, s’abreuvaient avidement à la petite rivière, laquelle tarissait à vue d’œil ; la tente de campagne du tsar, montée par de prompts serviteurs…
« Se peut-il, songeait Roman, que tout cela – ces pentes couvertes d’une herbe drue, ce saule penché sur l’onde, la rivière elle-même – se soit trouvé déjà là, à l’époque ? Se peut-il que cette glaise, ces roches erratiques près du petit pont aient vu les Tatars et le Temps des Troubles, les moujiks de Pougatchev et les grognards de Napoléon ? »
Vladimir Sorokine a travaillé plusieurs années, entre 1985 et 1989, sur « Roman », son premier texte aussi imposant (avec ses 580 pages) à l’époque, après la parution de quelques novellas. Publié en 1994, traduit tardivement en français chez Verdier en 2010 (à partir de l’édition originale révisée par l’auteur en 2004) par Anne Coldefy-Faucard (qui se sort très efficacement de ce délicat exercice, fût-ce en abusant peut-être un peu des notes de bas de page de « culture russe », jusqu’aux diminutifs des prénoms notamment), ce roman constitue de facto l’ancrage primordial, la fondation sur laquelle l’auteur élaborera par la suite, directement ou indirectement, les fusées redoutables du « Lard bleu » (1999), de la trilogie de « La glace » (2002-2004-2005), ou de la « Journée d’un opritchnik » (2006), par exemple. Son plus récent « La tourmente » (2010) constitue aussi à plus d’un titre un rusé clin d’œil à ce précurseur.
Russie, vers 1880-1890. Après plusieurs années passées en tant qu’avocat à Saint-Pétersbourg, le jeune Roman Alexiévitch a décidé, à 32 ans, de devenir peintre, et de se retirer, en quelque sorte, loin du brouhaha de la capitale, à la campagne familiale de la Roide-Combe, où il a passé toute son enfance et son adolescence dans le giron de ses parents adoptifs, oncle Anton et tante Lidia. Renouant instantanément avec le rêve bucolique emblématique d’une certaine classe éduquée russe du XIXe siècle, il se plonge avec délices dans un bain de jouvence paisible et enchanteur, alternant visites aux amis, exploration de la lumière sur la toile et douces ripailles amicales, se payant même le luxe d’enterrer définitivement un amour de jeunesse ayant ranci entretemps, et d’en découvrir un autre, foudroyant. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, la Russie intemporelle.
Au premier regard, la maison pouvait sembler la perfection même : entourée de buissons de lilas, elle était peinte en bleu azur ; l’auvent du perron reposait sur deux colonnes de bois, les gouttières brillaient de toute leur ferraille neuve, le toit faisait honneur au couvreur, le belvédère aux vitres étincelantes s’agrémentait de sa petite tour ornée d’un coq ouvragé.
À l’intérieur, cependant, les choses étaient loin d’être aussi irréprochables : le plancher que foulait à présent Roman était vermoulu et se creusait, promettant de s’effondrer quelque jour, les terrasses étaient encombrées, ensevelies sous un tas de vieilleries – commodes au bois fendillé, corbeilles percées, cages à oiseaux, innombrables pots de fleurs, malles, sacs de voyage, cartons à chapeaux cabossés, sans parler des livres gisant un peu partout. Le salon, en dépit de son air pompeux, évoquait un aristocrate ruiné : le piano noir et massif, au vernis craquelé et aux touches jaunies, était définitivement délabré et désaccordé. Le tapis persan montrait des points d’usure, le divan de cuir était défoncé, à l’instar des fauteuils. Les tableaux, qui couvraient presque entièrement les deux murs principaux – représentant, pour l’un, la baie de Naples par une nuit de lune et, pour un autre, la bataille de Cannes -, s’écaillaient, leurs cadres dorés étaient pitoyables et des bouts de dorure crissaient sous les pieds, telles des coquilles d’œufs au moment de Pâques. Le buste en marbre de Voltaire, en revanche, sur son socle nervuré, rayonnait de blancheur. Les pièces étaient exiguës, poussiéreuses, les vieux meubles fendillés et si bancals que les portes des armoires ne fermaient plus et que seul un Hercule eût été en mesure, peut-être, d’ouvrir les tiroirs.
Comme beaucoup d’auteurs russes tout au long du XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui inclus, aussi atypiques ou révolutionnaires soient-ils (la culture littéraire russe ne comporte aucune tentation de tabula rasa, bien au contraire), Vladimir Sorokine maîtrise à la perfection les codes et les contenus des classiques russes, et les 400 premières pages de ce « Roman » évoluent donc avec une extraordinaire aisance entre l’hommage et la parodie, recyclant avec beaucoup de naturel des scènes que l’on jurerait échappées des fondations mythiques d’Alexandre Pouchkine (dont André Markowicz rappelle régulièrement, avec force et avec raison, dans son « Soleil d’Alexandre » comme dans ses « Partages » – le premier comme le deuxième tome – l’importance primordiale en la matière), des économies domestiques sous tension d’Anton Tchékhov, des parcours de chasse d’Ivan Tourguéniev, ou des tournées campagnardes de Nicolas Gogol. : l’auteur nous régale ainsi de collations (concombres, champignons, pommes marinées à la recette secrète, vodka), de déjeuner de Pâques, de pique-nique, de chasse, de fauchage, d’étuve, de cueillette des champignons, de l’incendie d’une grange, de chansons, de débats animés sur la philosophie, l’histoire et la Russie, et jusqu’à des fiançailles dans les larmes de joie et à d’homériques festivités de noce, incluant la bagarre entre moujiks ivres. Mais derrière la maîtrise si impressionnante de cette façade idyllique, quelque chose rampe. La récurrence du personnage d’Hamlet, et de quelque pourriture danoise, dans les discours entre amis, les fissures dans les isbas, le caractère rayé des disques que se serinent les uns aux autres les acteurs de cette pièce laissent peut-être présager la déconstruction du mythe qui est ici entreprise, extrêmement insidieusement. Souvent qualifié, un peu à l’économie critique, d’écrivain postmoderniste, Vladimir Sorokine a l’élégance de jeter sur notre piste quelques indices soigneusement emballés dans son foisonnement joyeusement équivoque, précisément.
Roman avait un don qui le plaçait au nombre des gens hors du commun, voire un peu étranges. Enfant, déjà, il avait remarqué qu’il prenait un vif plaisir à éclairer les événements de manière à captiver ses auditeurs, à éveiller en eux certain frémissement, afin d’être en mesure de vibrer à son tour. Cela n’impliquait nullement qu’il mentît ou se perdît en élucubrations ; bien au contraire, il rapportait tout très exactement, dans les moindres détails, mais s’y employait comme nul autre. On eût dit qu’il allumait en lui-même quelque invisible lanterne magique, la braquait sur l’événement décrit, et tout étincelait soudain de fantastiques couleurs, embrasant et emportant l’auditoire et le conteur, de sorte qu’on n’eût su démêler lequel en retirait le plus d’amusement.
À présent encore, évoquant, à l’intention de son oncle, la première de cette pièce, il sentait, dans sa poitrine, la présence de cette « lanterne magique », éprouvait le désir inspiré d’enflammer son interlocuteur. Il se mit donc à raconter, à sa manière passionnée et enthousiaste.
Comme Andreï Platonov et comme Antoine Volodine, Vladimir Sorokine dispose lui aussi de cette rare capacité à saisir une herbe pour en extraire un golem. Les détails y sont sincères, entiers, vitaux, et ne doivent guère être négligés, au risque d’un choc encore plus violent lorsque les masques tombent, que l’immobilité déployée, enrobante, s’évanouit ou s’efface, que la hache du Raskolnikov de Fédor Dostoïevski s’échoue sur la berge du si paisible Don de Mikhaïl Cholokhov, et que l’abîme se fait jour. L’exaltation sans visée, le vide assumé, la vodka, le pain et les jeux, et même les discussions philosophiques répétitives, tous ces rituels vidés de leur éventuel sens premier sont désormais prêts à entamer leur mutation, leur transformation terrible en leur propre face cachée peut-être, atroce : l’assoupissement guette, l’absence de vigilance devient règle, la stase règne en maître en laissant libres les mains des prestidigitateurs politiques.
Ce n’est pas tant le Lafcadio d’André Gide qui surgit alors des ombres, tout armé de gratuité, mais une version authentiquement dévoyée de Langlois, un « Roi sans divertissement » qui, à la différence de celui de Jean Giono, est aussi un lare de colère, petit, familier et dévastateur. Inventant in fine un rituel de l’obsession plutôt que du mépris, Vladimir Sorokine nous offre l’irruption de l’impensable, casse brutalement l’idole immobile de l’idylle champêtre et pascaliennement distrayante, et nous renvoie à la nudité de nos êtres face au gouffre. Au tintement d’une clochette apocalyptique que personne n’aurait pu deviner, et face à laquelle la nature des croyances préalables n’a plus guère d’importance.
– Fichu temps… maugréa Kliouguine en regagnant la rive.
Il trébucha et se retrouva à l’eau.
Roman, envoûté par la puissance de la nuée, n’avait pas bougé.
Le deuxième coup de tonnerre fut brutal, à croire que, là-haut, des mains monstrueuses débitaient, déchiraient un arbre énorme, dont les deux moitiés s’abattaient sur le sol, faisant trembler les vitres.
– Vite, Roman ! cria Anton Petrovitch, avant de se réfugier dans l’étuve avec ses compagnons.
Timochka accourut et, pataugeant, attrapa le samovar qu’il emporta.
Roman ne bougeait toujours pas.
Le troisième coup fut plus fort que les précédents : les petites cuillers, oubliées dans les chopes, tintèrent plaintivement. Roman sentit l’eau tanguer.
Aussitôt, de grosses gouttes d’eau tombèrent, de plus en plus nombreuses, troublant la surface sombre de l’eau où elles traçaient des cercles qui s’élargissaient et se confondaient. Ils se multiplièrent d’abord, puis une muraille d’eau blanche s’abattit, d’u coup. La rivière parut bouillonner et se soulever. Roman regardait l’averse fouetter la table, jouer dans les chopes, emplir les coupelles de confiture, frapper les petits pâtés dorés et les vatrouchkas. Il reprit son thé dilué par la pluie : le goût en était stupéfiant. Des ruisselets de fraîcheur coulaient sur son visage, ses épaules et son torse. Il reposa sa chope, se tourna vers la rivière en ébullition et, prenant son élan, se remit à nager, fendant la surface fragile de l’onde.
Le ciel se déchaînait au-dessus de lui, derrière quelqu’un criait son nom, mais il nageait dans l’élément blanc en furie. Il nageait, indifférent à tout, un sourire aux lèvres.
Vladimir Sorokine
Vladimir Sorokine - Roman - éditions Verdier
Coup de cœur (relecture) de Charybde2, publié le 24 février 2017
l'acheter chez Charybde, ici