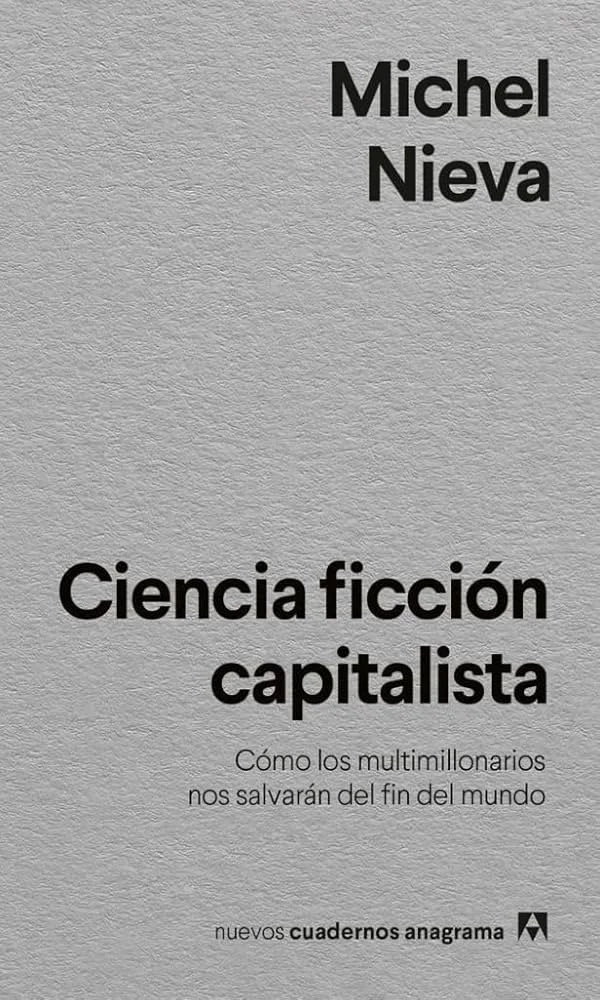Mieux comprendre rat-taïaut et l'agent orange avec "L’Enfance du monde " / "La science-fiction capitaliste"
Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.
Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.
De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.
Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :
– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?
– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?
– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?
Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.
De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.
Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.
Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.
Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).
Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.
En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.
Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.
En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :
– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !
Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.
Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.
Du boudin !
Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.
« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).
Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.
Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.
De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.
Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…
Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.
Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !
Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?
Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.
☀︎
Notes de lecture 2024, Nouveautés
Note de lecture : « L’Enfance du monde » / « La science-fiction capitaliste » (Michel Nieva)
Posté par Hugues ⋅ 23 juillet 2025 ⋅ Poster un commentaire
Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.
x
x
x
Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.
De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.
Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :
– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?
– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?
– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?
Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.
De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.
Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.
x
Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.
Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).
Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.
x
En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.
Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.
En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :
– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !
Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.
Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.
Du boudin !
Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.
x
x
x
« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).
x
Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.
Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.
De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.
Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…
Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.
x
Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !
Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?
Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.
La science-fiction capitaliste – Ou comment les milliardaires vont nous sauver de l’apocalypse
x
Le techno-multimilliardaire ne sait pas vraiment lire, quelles que soient les apparences éventuelles, mais il sait détourner – on le sait au moins, toutes proportions gardées, depuis le fondamental « Le nouvel esprit du capitalisme » (1999) de Luc Boltanski et Eve Chiapello. Mais on lui sert si volontiers la soupe, économique et médiatique, le moment venu, qu’il parvient à faire semblant très longtemps – voire à réécrire les créations passées à l’aune de son propre appétit – insatiable. Si Kim Stanley Robinson s’arrache à raison les cheveux en entendant les travestissements de son œuvre que colporte si volontiers Elon Musk, et si Iain M. Banks se retournerait à coup sûr dans sa tombe face aux avanies que fait subir le même forcené à la sienne, c’est à partir d’un autre exemple séminal que procède Michel Nieva dans ce bref essai, publié en 2024 et traduit également par Sébastien Rutès pour inclusion, quasiment en postface, dans l’édition française de « L’enfance du monde ». : il s’agit du fondamental « Le Samouraï virtuel » (dont, une fois de plus, le titre français fait légèrement frémir de honte par rapport à l’original « Snow Crash »), publié en 1992 par Neal Stephenson.
Ce qui frappe dans ce roman publié en 1992, c’est qu’il imagine une époque qu’on ne peut qualifier de dystopique que dans la mesure où elle renforce, dans un avenir pas si lointain, des logiques néolibérales de précarisation du travail, de délocalisation industrielle et de renforcement du pouvoir des mégacorporations face à un reliquat d’État en faillite qui existaient déjà aux États-Unis à l’époque où le roman a été écrit. Néanmoins, peut-être à cause de son contexte de publication particulier – sur la Côte ouest, deux ans avant le début de l’usage commercial d’internet pour les ordinateurs personnels -, sa dimension de pamphlet lapidaire contre le capitalisme sauvage est passée inaperçue et s’est vue immédiatement éclipsée par les innovations technologiques que le roman conjecturait dans ce futur néolibéral frénétique.
En quelques années, Le Samouraï virtuel s’est taillé dans la Silicon Valley la réputation d’un oracle de légende ayant inspiré quelques-unes des technologies qui deviendraient des icônes du capitalisme digital, comme par exemple la cryptomonnaie, Google Earth, les applications de livraison à domicile, le jeu vidéo Quake, la plateforme Second Life, Wikipédia, le métavers (lequel à dire vrai avait déjà été inventé par William Gibson dans Neuromancien, sous le nom évocateur de « Matrice »), en plus d’avoir popularisé le terme d’origine sanskrite « avatar ». Ce livre a imaginé avant l’heure tellement de produits et de concepts informatiques que les compagnies de la Silicon Valley ont obligé leurs créatifs à le lire, et que des gourous du secteur comme Bill Gates, Sergueï Brin, John Carmack ou Peter Thiel ont reconnu une filiation intellectuelle entre leurs créations et celles présentes dans Le Samouraï virtuel.
Étant donné les qualités futurologiques de son œuvre, Neal Stephenson n’a pas manqué d’offres de la part de différentes sociétés d’innovation technologique? Il a d’abord mis son imagination, nourrie de space opera et de fanzines cyberpunk, au service de Blue Origin, la compagnie spatiale de Jeff Bezos, où il a travaillé à l’innovation astronautique pendant sept ans, mais il occupe désormais le poste de « futurologue » chez Magic Leap, une compagnie qui développe des casques de réalité augmentée à des fins commerciales et scientifiques, ce qui en fait un concurrent du groupe Meta.
En 2021, au moment où Zuckerberg a annoncé la création de son métavers, Neal Stephenson a démenti sur Twitter toute responsabilité intellectuelle dans le projet. Cependant, toujours dans un tweet, il a expliqué que la raison de ce désengagement n’était pas qu’il condamnait la prostitution de ce qui avait d’abord été une critique acerbe du capitalisme à une des compagnies les plus monopolistes et multimilliardaires de la planète, mais tout simplement que son idée originale ne lui rapportait aucun droit d’auteur.
Comme on peut le lire, le caustique Michel Nieva n’hésite pas un instant à décaper les complaisances et les connivences au sein d’un milieu littéraire science-fictif historique (mais aussi contemporain, les proxy fights autour des votes pour le prix Hugo en 2015 en témoignaient hélas encore récemment) qui n’a pas toujours uniquement brillé par son progressisme social et politique. Il traite ici directement, sous une forme ironique et enjouée, l’emprise idéologique et culturelle des techno-milliardaires (qui ont pourtant fréquemment le culot, pour les plus vociférants d’entre eux, de prétendre ne pas pouvoir s’exprimer), en particulier autour de la conquête spatiale (remédiant ainsi indirectement au principal point aveugle de l’essai par ailleurs excellent et stimulant de Irénée Regnauld et Arnaud Saint-Martin, « Une histoire de la conquête spatiale », également publié en 2024) et de la quête de l’immortalité (nous rappelant toujours à quel point le « Jack Barron et l’éternité » de Norman Spinrad, pourtant publié en 1969, ne prend guère de rides au fil du temps – si l’on ose dire sur pareil sujet).
Porté par un souffle proprement jubilatoire, ce petit essai en six chapitres et un épilogue, avec des titres aussi évocateurs que « Métavers, tourisme spatial, immortalité, sojapunk », « Le changement climatique, la grande fierté de l’homme blanc » ou « La science-fiction capitaliste, phase supérieure du colonialisme », illustre à la perfection ce qu’une science-fiction critique et incisive peut produire à l’encontre d’un discours qui – malgré le tour de passe-passe insensé du « on ne peut plus rien dire » – demeure bien le discours dominant, et surtout celui qui dirige les actions et les inactions des powers that be. Et l’on se reportera avec joie à la dernière phrase du texte, que je vous laisse le soin de découvrir le moment venu sans la citer ici.
Ces exemples – le métavers de Zuckerberg, le business interplanétaire de SpaceX, l’immortalité d’Auubrey de Grey ou le « sojapunk » de Grobocopatel – sont autant de preuves éclatantes d’une tendance de plus en plus visible et globale : l’appropriation par le capitalisme technologique du langage de la science-fiction, le séduisant storytelling d’un futur hypertechnologique que les mégacorporations et leurs directeurs généraux instrumentalisent non seulement pour habiller leurs produits mais aussi pour offrir une solution hypothétique aux graves crises socio-environnementales que le capitalisme lui-même a provoquées. On a dit qu’il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme, eh bien ! ces compagnies développement déjà le capitalisme extra-terrestre qui lui survivra. Quant à leurs dirigeants, ils cherchent à nous faire croire que, si nous aussi nous voulons survivre, il nous faut acheter leurs produits, car rien d’autre ne pourra nous sauver – du moins ceux qui peuvent se les offrir.
La science-fiction capitaliste offre le récit fantastique d’une « humanité sans monde », faite de touristes qui vivent mille ans et voyagent à travers le cosmos pour prendre des selfies pendant que la Terre s’embrase, récit qui permet à l’establishment industriel de monopoliser le droit à penser le fuur, après avoir plongé les sociétés dans l’incapacité à projeter leurs propres visions. Dans une citation aussi célèbre qu’inspirante tirée des textes fondateurs de SpaceX, Elon Musk dit : « Tout le monde a envie de se lever le matin en se disant que l’avenir sera grandiose : voilà ce que veut dire devenir une civilisation qui voyage dans l’espace. Il s’agit de croire au futur et de penser qu’il sera meilleur que le passé. Je ne peux rien imaginer de plus excitant que de voyager là-haut et de vivre parmi les étoiles ». En même temps que le capital condamne les travailleur.euses du monde entier à un présent continuellement fait d’instabilité, d’incertitude et d’endettement, les milliardaires se posent comme les seuls capables d’anticiper et de donner de la valeur à l’avenir. La science-fiction capitaliste est une violence qui réserve aux grandes compagnies le monopole du droit à imaginer notre futur. Voilà comment, dans la continuité directe de cet esprit de l’époque que Mark Fisher a qualifié de « réalisme capitaliste », ce sentiment nihiliste hégémonique que le capitalisme est le seul système politique et économique viable sous prétexte qu’on n’arrive pas à en imaginer de meilleur ni de pire, nous vivons une ère où le capitalisme ornemente des atours d’une esthétique hyperfuturiste le soupçon que c’est son fonctionnement même qui nous conduit à la catastrophe.
Hugues Charybde, le 8/09/2025
Michel Nieva - L’enfance du monde, suivi de La science-fiction capitaliste - collection Chimères, ed Christian Bourgois
L’acheter chez Charybde, ici