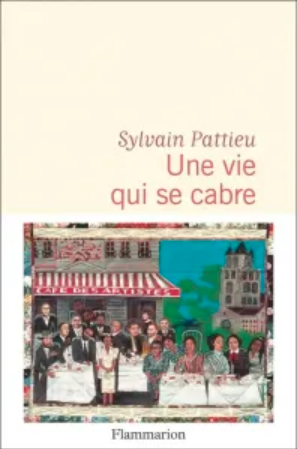Retour d'Afrique (avec droit de vote)
Et si la France avait donné le droit de vote à tous ses colonisés en 1946 ? Poétique et incisive, sans complaisance ni idéalisme, une formidable uchronie prenant toutes les allures d’une utopie acérée, et salutaire.
Le sang sur le visage de son père, Marie-des-Neiges s’en souvenait, du loin de son enfance, elle revoyait comment il coexistait sur cette tête aimée en plusieurs états : séché, il lui maculait les joues et le menton ; en petites rigoles, il empruntait les plis, les rides et les anfractuosités qu’elle pensait chemins pour ses petits doigts ; amas vif sur chair, il palpitait autour de la plaie du front. Pourtant son père souriait, et la petite fille ne comprenait plus si elle devait pleurer ou se réjouir des ravages. Il était rentré alors que la lumière passait du jour à la nuit, Marie-des-Neiges en le voyant avait poussé un cri, sa mère avait levé les yeux au ciel et serré la mâchoire pour garder son calme. Son père l’avait prise par les épaules, c’est un grand jour, il avait dit, ne crains pas mes blessures, ce n’est rien, la grève tient, ils nous matraquent mais elle tient, ils arrêtent certains d’entre nous mais les autres continuent, nous abattrons deux ennemis à la fois, le colonialisme et l’exploitation.
Marie-des-Neiges ne savait pas tous les mots mais elle sentait bien, dans le ton de son père, qu’il se passait des événements importants. Il parlait à sa hauteur, doucement. Sa mère lui avait donné un mouchoir, pour essuyer le sang, et elle aussi avait pris sa fille par les épaules, de l’autre côté, assise derrière elle, de sorte qu’ils lui chuchotaient chacun dans une oreille, détourne tes yeux de la vue des choses vaines, elle disait, citant les psaumes, comme souvent. Ce n’est pas qu’elle trouvait inutile le combat du père, elle soutenait et elle admirait, même, la grève de la Fédération des travailleurs indigènes des chemins de fer de l’Afrique-Occidentale française. Simplement elle voyait de la vanité dans ce retour ensanglanté et joyeux, or ce trait de caractère était un péché mortel, même si sa propre apparence, hautaine, pouvait laisser croire qu’elle s’y complaisait.
Il y avait aussi chez sa mère une certaine condescendance face à la grève des cheminots, qui durait depuis trois mois. Deux ans auparavant, en 1944, alors que la guerre n’était pas terminée, elle avait participé aux mouvements des femmes des Quatre-Communes, Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque, pour obtenir le droit de vote comme les citoyennes de métropole. Lorsqu’elle discutait avec son mari, cette antériorité dans la lutte et dans la victoire, évoquée en de subtils sous-entendus, faisait dévier son air sévère : ses paupières plissaient, les coins de ses lèvres remontaient, légers signes du plus profond des contentements.
Le soir où son père était revenu en sang, l’Empire français était presque mort. Il avait connu en 1940 l’humiliation de la défaite, l’occupation nazie. Puis les troupes coloniales avaient joué un rôle important au sein des armées françaises pour la libération du pays. Elles avaient été accueillies avec chaleur dans tous les territoires libérés. Il était temps de mettre l’Empire à bas, son père comme sa mère l’avaient compris, voilà pourquoi ils avaient mené la lutte. Les députés issus des populations colonisées la menaient aussi à l’Assemblée constituante élue en 1945. Ils s’étaient coordonnés pour défendre les droits des colonisés et, en avril 1946, la loi Lamine Gueye, défendue par le député socialiste de Dakar, avait été adoptée par l’Assemblée nationale constituante : elle attribuait la citoyenneté française à tous les ressortissants de l’Empire. La loi précisait : « Tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d’outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens ». Le député Édouard Herriot, maire de Lyon, membre du Parti radical et ancien pilier de la IIIe République, avait tonné : « la France ne doit pas devenir la colonie de ses colonies ». Ainsi, il avait exprimé la peur de tous les tenants de l’ancien ordre. Tel était l’enjeu crucial : mesurer l’étendue de l’application de cette loi et la définition de ces « lois particulières ». Les vieux politiciens de l’Empire craignaient de donner plus d’influence aux colonisés et rechignaient à payer pour ces territoires, ils ne voulaient pas de la citoyenneté, ni du droit de vote, ni des droits sociaux.
En quelques mois tout était devenu possible : ceux et celles de France hexagonale, de petite France comme on disait désormais, reconnaissaient la part prise par les colonisés dans la victoire contre le nazisme, tandis que, dans les colonies, la domination ne passait plus. Les luttes sociales dans tout l’Empire et la peur d’une révolution communiste avaient été déterminantes. Il s’en était fallu de peu, de même que pour l’amendement Wallon instituant définitivement la République, en 1875, à une voix près. L’Union française avait remplacé l’Empire, Aimé Césaire en avait été élu président, et, dans l’entre-deux de ces bouleversements profonds, le père de Marie-des-Neiges s’était mis en grève, avec ses camarades, il avait manifesté, et il avait saigné d’un coup de matraque.
Plus tard on reconnaîtrait à ses deux parents le statut de pionniers, étonnant et honorifique détournement d’un vocabulaire d’origine pourtant coloniale. Chacun à sa manière, ils avaient pris part aux profonds changements de ces années-là et à la mise en place de l’Union française. Ce courage et cette action commune étaient sans doute l’un des fondements de ce couple si disparate en apparence, le syndicaliste marxisant et la chrétienne fervente. Ils avaient reçu la médaille qui officialisait leur statut des mains du président Césaire, quelques semaines à peine avant son assassinat par un Européen d’Algérie, et ils n’auraient jamais avoué, ni l’un ni l’autre, qu’ils en tiraient une immense fierté. Être fille de pionniers avait valu à Marie-des-Neiges sa bourse pour l’école normale d’institutrices d’Aix-en-Provence.
Que serait-il advenu si la loi Lamine Guèye (du nom du député affilié SFIO de Dakar, à l’époque), conférant le statut de citoyen à l’ensemble des habitantes et habitants de ce qui s’appelait alors encore, au sortir de la deuxième guerre mondiale, l’Empire français, loi votée par l’Assemblée constituante française le 7 mai 1946, n’avait pas été vidée de l’essentiel de sa substance politique réelle par celle du 5 octobre 1946, restreignant le droit de vote aux seuls citoyens « de statut français » et assimilés, sous prétexte des « insuffisances de l’état-civil » dans les colonies ? Alors, comme le craignait publiquement le député Édouard Herriot de (surtout) triste mémoire, la France aurait-elle été « colonisée par ses colonies » ?
C’est à ce formidable et vertigineux « Et si ? » que nous invite Sylvain Pattieu dans son roman « Une vie qui se cabre », publié en 2024 chez Flammarion. Conduite à travers les yeux de Marie-des-Neiges, jeune élève boursière, d’origine sénégalaise, de l’École Normale d’Instituteurs d’Aix-en-Provence, en 1959, alors que Suzanne Césaire est présidente de la République française, ayant succédé au précédent titulaire du poste, son mari, Aimé Césaire, assassiné par un colon algérien extrémiste, cette investigation uchronique se révèle à la lecture particulièrement puissante et judicieuse, davantage encore dans le contexte de repli identitaire exacerbé et de remplacement fantasmatique et complotiste qui hante une partie de la France contemporaine, cette France historiquement issue en effet de l’hypocrisie assumée de 1946, établissant le double collège électoral dans l’Empire pour permettre aux seuls Français blancs, métropolitains et assimilés de continuer à décider, seuls, pour encore une grosse dizaine d’années, du sort des colonisés – qui obtiendront ensuite fort logiquement, et parfois dans l’extrême douleur, leur indépendance vis-à-vis d’un « vieux pays » leur ayant refusé cyniquement d’être citoyens à part entière.
Madame Condé arrivait dans sa voiture, un long véhicule noir aux jantes épaisses, monte, elle lui disait, d’un ton rude mais petit sourire aux lèvres, et Marie-des-Neiges s’installait sur le siège passager. Elle était heureuse d’avoir été choisie entre les autres élèves. Madame Condé démarrait et faisait rugir le moteur, elle emballait les roues, soulevait la poussière. Elle aimait s’aventurer en dehors de la ville pour rouler vite. Ça n’était plus une automobile mais un élan furieux de métal, de verre et de caoutchouc, la machine fendait l’air, labourait la terre, elle volait par-dessus les nids-de-poule et frôlait les obstacles. Les autres véhicules s’écartaient et klaxonnaient, les vaches et animaux divers valdinguaient en échappant de peu à la mort, les virages se négociaient à la dernière seconde, le soleil ou la pluie importaient peu. Marie-des-Neiges se cramponnait, elle tournait souvent la tête et sur le bord de la route les acacias, les rôniers, les jujubiers se mélangeaient, la vitesse leur faisait prendre couleur commune, larges bandes jaunes et vertes qui s’étiraient tout au long du trajet.
Madame Condé regardait droit devant, elle tenait fermement le volant, elle prenait son plaisir. Elle se vantait d’avoir souvent fait monter des hommes dont l’arrogance laissait place à la peur, aux poings crispés, aux gémissements à mesure que les paysages défilaient de plus en plus vite. Souvent ils sortaient de la voiture sitôt arrêtée, ils se signaient, ils tripotaient leur chapelet ou ils se cachaient pour vomir. Madame Condé s’amusait. Elle roulait pour rouler, parce qu’elle aimait ça, pour la vitesse. Elle avait souvent dû céder aux hommes en toutes sortes de domaines, elle les avait crus et ils lui avaient menti, elle avait dépendu d’eux, alors dans ces escapades au volant elle tenait une revanche taquine.
Marie-des-Neiges aussi avait peur mais elle se sentait flattée de cet honneur. Tout le monde – ou plutôt ceux et celles dont l’avis comptait pour Marie-des-Neiges – tenait madame Condé en haute considération. Elle venait de l’Hexagone, où elle avait fait ses études, et plus tôt encore elle était née et avait grandi en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Elle lui avait parlé de son arrivée en petite France à seize ans, pour intégrer le lycée Fénelon. Quand Marie-des-Neiges l’avait connue, elle n’était pas encore la grande écrivaine, personne n’aurait pu s’en douter, même si sa nomination à Dakar avait fait grande impression. Elle venait des Caraïbes, comme le président et la présidente Césaire. Il ne s’agissait pas de la même île que la Martinique mais de loin tout semblait proche. Les Antillais, pensait le père de Marie-des-Neiges, avaient tendance à se croire plus évolués que les Africains, et l’accession successive à la présidence d’Aimé puis de Suzanne n’avait rien arrangé à l’affaire. Il les soutenait l’un et l’autre, mais il en était néanmoins courroucé. Nous sommes plus nombreux, il disait, la logique aurait voulu que ce soit un Africain et non un Antillais qui préside l’Union française.
Madame Condé avait un peu de la morgue désagréable de ses compatriotes. Elle était venue pour connaître l’Afrique, le continent des origines, avec tout le fatras d’illusions, de malentendus et de maladresses que cela supposait. Mais, grâce à sa prestance et à sa hauteur d’âme, on ne lui en tenait pas rigueur. Sa vive intelligence la mettait de toute façon au-dessus. Elle s’était rapidement détachée de la fascination naïve qui l’avait conduite au voyage. Elle faisait bien son travail de professeure. Elle participait aux différents cercles intellectuels et militants de la ville. Les élèves, leurs parents, ses collègues, tous et toutes étaient tombés en admiration.
Huit ans après l’excellent « Et que celui qui a soif vienne » et son entrechoc rusé de la piraterie caraïbe et de la traite des esclaves, cinq ans après l’exceptionnel « Forêt-furieuse » et son échappée belle face aux milices religieuses mafieuses d’une France contemporaine déchirée par l’effondrement énergétique et la guerre civile, « Une vie qui se cabre » réussit un pari pourtant presque insensé, celui de donner à penser et à ressentir, sous une forme subtile très éloignée des caricatures à la serpe que manient trop d’uchronies pourtant infiniment moins ambitieuses, une décolonisation des corps et des esprits plutôt que des territoires, une culture plurielle qui n’ignore ni les frottements éventuellement cruels ni les enracinements volontiers délétères, parvenant à mêler d’un même souffle inattendu le très joueur et le parfaitement sérieux (« Ne laissez jamais dire, d’aucune des parties de l’Union française, qu’elle n’a pas d’histoire »).
En résonance presque permanente avec les années marseillaises du poète jamaïcain-américain (et clochard céleste avant la lettre) Claude McKay (« Banjo », 1929), en imaginant des destins ô combien différents de la réalité historique pour des personnages-clé tels que Suzanne et Aimé Césaire, Maryse Condé (pour laquelle Sylvain Pattieu imagine une mangrove métaphorique que ne renierait peut-être pas Michael Roch), Gerty Archimède, Jenny Alpha ou Georges Pompidou (mais oui !), entre autres, en intégrant de manière joliment sous-jacente certains motifs que l’on trouverait aussi chez Abdourahman A. Waberi (« Aux États-Unis d’Afrique », 2006), Roland C. Wagner (« Rêves de gloire », 2011) ou même Mohamed Mbougar Sarr (« La plus secrète mémoire des hommes », 2021), « Une vie qui se cabre » nous rappelle s’il était nécessaire que l’historien lucide et sans complaisance qu’est d’origine Sylvain Pattieu (songeons ainsi à ses récits-essais « Avant de disparaître » ou « Nous avons arpenté un chemin caillouteux », par exemple) se double bien d’un poète audacieux et spéculatif (que l’on rencontrait aussi au fil des pages de son recueil « En armes ! »), pour nous offrir une rare expérience de pensée, une spéculation romanesque comme bien peu d’uchronies, et même de romans tout simplement, en sont capables.
La ville bouillonnait d’une colère joyeuse, elle débordait, n’épargnait pas les hommes, militants compris. Ne soyez pas des colons dans votre propre maison, disaient les femmes. Laissez-nous être à vos côtés, pas en dessous de vous. Les chefs du RDA, le Rassemblement démocratique africain, le parti des colonisés, avaient craint cet enthousiasme, au début. Puis ils avaient compris le profit qu’ils pouvaient en tirer. Nul ne savait comment voteraient les femmes. Elles avaient rempli les salles de meeting du RDA, elles y avaient crié et chanté. On les voyait rarement à la tribune. Elles avaient néanmoins compté dans le triomphe électoral. Édith prônait l’amour mais pas la nuance. Césaire nous doit tout, elle disait souvent. La France sera sauvée par ses colonies et par ses femmes.
Pourtant, cette époque avait aussi été celle de la tristesse. Certaines compagnes de lutte, des femmes blanches, avaient pris peur. Tout allait trop vite. Elles n’étaient pas prêtes. Elles avaient quitté Dakar pour rentrer dans l’Hexagone, effrayées. Elles combattaient la polygamie, mais ne pensaient pas que les femmes des colonies eussent la capacité de voter. Ça viendra, elles écrivaient. Elles chipotent, elles tergiversent, elles comptent nos droits. Édith leur répondait, longues lettres de déception, grande tristesse face à ses sœurs égarées. Elle avait fini par ne plus écrire, par laisser sans réponse leurs pauvres justifications. Laisse les morts ensevelir leurs morts, elle disait, elles ne sont pas prêtes pour le Royaume de Dieu. Elles y viendront, elles suivront la route que nous défrichons.
Guy était convaincu par Marx : dans la famille, l’homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du prolétariat. Néanmoins il tenait à son repas servi, à son linge propre. Il était plus accommodant que beaucoup d’hommes. Il était persuadé cependant que, sans la menace d’une nouvelle grève, l’agitation des femmes n’aurait pas suffi pour que les élections aient bien lieu. Ton bon Dieu et tes bonnes femmes ne suffisent pas, sans la classe ouvrière. Va la chercher dans la brousse, ta classe ouvrière, elle répondait. La plupart du temps, il se taisait, il bourrait sa pipe, il fumait. Tu ne sais pas tout, il y a eu des tractations à Paris. Guy menaçait Césaire. S’il veut nous exploiter, comme les Blancs, il aura affaire à nous. Il n’avait pas pleine confiance en Senghor, qui avait trop de diplômes, et dont le père possédait mille vaches, vingt ânes, des dromadaires, ni en Gueye, trop modéré, ni en Houphouët-Boigny, qui restait un riche planteur de cacao. Il a fait voter la loi contre le travail forcé, rappelait Édith, un doigt pointé vers sa pipe. Il est fort en bondieuseries, comme Senghor, c’est pour ça qu’il te plaît, mais c’est un patron, qui parle pour les autres patrons, les planteurs. L’abolition du travail forcé, la belle affaire, la bourgeoisie a supprimé les privilèges, pendant la Révolution française, ça ne les a pas empêchés de continuer à exploiter.
Parfois les oreilles chauffaient trop, Marie-des-Neiges sortait, elle allait sur sa couche ou dans le jardin, elle entendait de loin la dispute qui se poursuivait. Selon son humeur, ça l’amusait ou ça la fatiguait. Quand Senghor était devenu ministre et que Lamine Gueye l’avait mal pris, le RDA avait scissionné et dans les rues de Dakar se battaient parfois, lors des campagnes électorales, les rouges contre les verts. Édith et Guy n’aimaient pas ces querelles, trop fratricides, et sur cet aspect ils pensaient d’une même tête. Front unique contre le colonialisme qui n’est pas encore totalement mort, disait son père, amour du prochain, disait sa mère.
Ses parents s’accordaient sur un point encore, le principal sans doute pour leur couple. Ils voulaient du bien pour elle, des études. Son père avait beau moquer le gros français de Senghor, son obsession à reprendre ses interlocuteurs sur leurs fautes de grammaire, moquer aussi les poèmes de Césaire – pour qui les a-t-il écrits, plaisantait-il, pas pour moi, en tout cas – sa mère avait beau défendre famille et foyer, ils étaient fiers de sa réussite, de ses bonnes notes à l’école. La voir partir était ce qu’ils craignaient le plus, mais toute leur éducation l’y avait conduite. Sans doute leur plus grande peur, à l’arrivée de l’enfant, avait été d’imaginer ce destin brisé. L’absence d’homme, de mari à qui se consacrer, les avait rassurés.
Ils l’aimaient, c’était sûr, c’est à la fois peu et une sacrée certitude pour cheminer de tranquille manière dans la vie. Cette source de force poussait Marie-des-Neiges, en plusde la confiance de madame Condé.
Hugues Charybde, le 5/05/2025
Sylvain Pattieu - Une vie qui se cabre - éditions Flammarion
l’acheter chez Charybde, ici