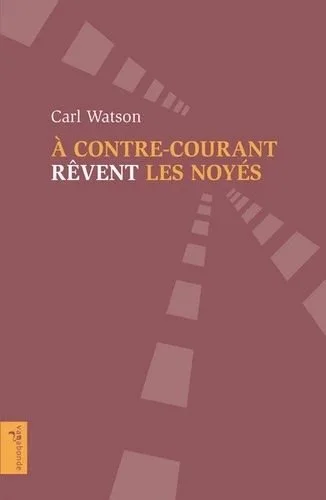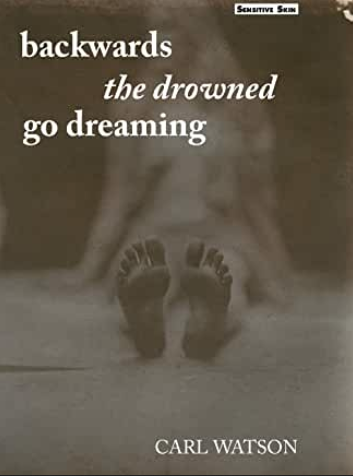Rêver des 60's en gardant la plume hors de l'eau avec Carl Watson
Sur la route américaine, au cœur de la dissolution des rêves des sixties, une vaste conversation intime et sauvage à propos d’identité : “Qui suis-je par rapport à ce qui bouge et s’agite autour de moi?”. Une langue hors du commun, poétique et incisive, pour une littérature hors des sentiers battus.
Et c’est bien là que tout démarre, en vérité.
Je demandais souvent qui je pouvais être à mon reflet dans le miroir, essayant de lui soutirer une réponse sur mon identité. Je jouais la comédie du gentil flic – méchant flic – Laurel et Hardy. La schizophrénie volontaire ne m’était pourtant d’aucun secours. À force, cela devient trop facile – bien sûr, on n’est jamais aussi défoncé que la première fois – et très vite une habitude. Après un certain nombre de verres, le masque protecteur vient comme un soulagement. L’avenir se met à l’ouvrage sur la structure osseuse. Le visage dans le miroir commence à s’harmoniser avec ceux des hommes qui, alignés sur le trottoir le long de la 3e Rue, ont dormi sous des couvertures moisies devant l’Armée du Salut, les hommes qui à cinq heures du matin attendent les cars qui les emmèneront aux champs, avec du whisky soda dans leurs gourdes et des saignements de gencives, les hommes assis au bord de leur lit dans des chambres humides, leur chemise sur un cintre et toutes leurs possessions terrestres fourrées dans cet espace de stockage de quatre mètres sur cinq, otages d’une guerre menée au-delà de leur sphère d’influence. La dislocation économique : c’est ainsi que les cracks de l’Université appelaient ce phénomène. C’était comme une sorte de tamisage du minerai d’or ou la séparation du blé de la balle. On plaçait la société sur une écumoire, on secouait, et ces paumés-là étaient les gens qui étaient tombés dans les trous. Des hommes que leurs femmes avaient quittés, ou bien à qui elles avaient été enlevées, des hommes dont les enfants étaient devenus des criminels, dont les amis s’étaient retournés contre eux ou détournés d’eux, surtout après que le gouvernement les eut baisés et qu’ils eurent perdu leur boulot, leur maison et le respect d’eux-mêmes au bénéfice d’escrocs en tout genre.
1975-1977. D’Illinois en Louisiane, de Texas en Californie, Frank et Tanya ont pris la route. Comme leurs prédécesseurs, célèbres ou bien moins connus, de la Beat Generation puis du Flower Power, ils arpentent les États-Unis, de job temporaire en période de dèche plus ou moins assumée, de beuverie sauvage en trip plus ou moins satisfaisant, de discussions nocturnes interminables en plans éventuellement foireux pouvant aisément conduire en taule, pour peu que la malchance s’en mêle. Elle ressemble un peu à Janis Joplin, il ne ressemble à personne en particulier. Elle chante bien, et aurait pu se lancer vraiment, peut-être. Il masque sous sa simplicité une culture non négligeable, acquise en livres et en tas. Ils ne savent pas exactement ce qu’ils cherchent, ni exactement ce qu’ils trouvent. Alors que les rêves sont en pleine descente, que les utopies, aussi malhabiles qu’elles aient pu être, semblent bien avoir échoué et que marchandisation, production et consommation se préparent résolument au triomphe à venir, leur couple à la fois surprenant et si banal résistera-t-il à ce qui se profile maintenant en eux et autour d’eux ?
Marshall McLuhan aurait pu dire que l’autoroute était le révélateur idéal de la puissance de l’ère industrielle, auquel cas une histoire de la route ne serait rien d’autre que la quantification de cette puissance – les kilomètres parcourus, les villes traversées, le nombre de filles qu’on a baisées, de caresses, d’orgasmes, tout ça finalement perdu, désagrégé, comme des arbres tombés dans la forêt à l’insu de tous, sans bruit. On dit que la passion est populaire, précisément parce qu’elle oblitère le temps. C’est la réalité « trop réelle » de la « petite mort ». Ça peut rendre intensément, intolérablement heureux durant la période la plus courte possible. Mais pour les solitaires maladroits de ce monde, ça ne fonctionne pas. Cela ne fait que prolonger le temps et attrister la vie.
Je me rendis au Morrison Café pour manger un morceau. J’étais bien là-bas. Mon reflet dans le miroir ne me surprenait plus. J’observai le cuisinier tandis qu’il sortait un hachoir du lave-vaisselle. Il y avait du sang dessus. Un aveugle avec une canne à bout rouge entra. La serveuse passa devant moi avec son plateau. Je ne posai pas de question. Une chaîne diffusait une émission sur la pêche, avec trois hommes dans un bateau. Le plat du jour était du canard ; je commandai du poulet frit avec de la purée ; la purée me fit baisser les yeux. Je me levai pour payer l’addition. Une vieille épée et une tête de cerf poussiéreuses étaient suspendues au-dessus de la caisse.
Je crois qu’Einstein a dit que le temps était lié à l’espace. Je pense au contraire que le temps et l’espace sont deux choses distinctes. On peut gaspiller son temps – il n’y a rien d’autre à en faire, de toute façon -, alors que l’espace doit être surmonté. L’existence peut être conçue comme une succession d’images qui visent à atteindre ce but. Parfois on les voit avant qu’elles ne s’en prennent à nous. Elles peuvent déterminer nos actes. Parfois on ne les voit pas pendant des années, pas avant d’avoir payé le prix de ces actes.
Quoi qu’il en soit, ce fut la conclusion de mon « été de l’amour ».
Carl Watson est redoutable. Quel que soit le fragment de réalité qu’il saisisse dans son filet langagier, il le confronte avec une malicieuse sauvagerie à l’irréalité qu’il comporte nécessairement, au mensonge qui l’irrigue et qui lui donne vie, à l’illusion indispensable qui l’enveloppe – et tire de cet entrechoc des munitions poétiques hautement explosives. Que ce soit à travers le mystérieux narrateur principal – non fiable s’il en est – de « Hôtel des actes irrévocables » (1997), par les acteurs de la folie à deux que constitue « Une vie psychosomatique » (2008) ou encore par le spectateur imaginatif et voyageur (presque) immobile de « Hank Stone et le cœur de craie » (2011), voire chez les divers protagonistes des somptueuses nouvelles de « Sous l’empire des oiseaux » (1997), il déploie pour nous régulièrement ce mélange détonant bien particulier de lucidité froide, d’errance intellectuelle furieuse et de poésie potentiellement désabusée qui ébranle avec maestria nos cités des illusions plus ou moins consenties. Publié en 2012, traduit en 2020 par Thierry Marignac, toujours aux éditions Vagabonde, qui portent ici particulièrement bien leur nom, « À contre-courant rêvent les noyés », jouant délicieusement avec la forme du road novel, en constitue une nouvelle démonstration particulièrement éclatante.
Dans le secteur de Burnside, les nuits pouvaient paraître prophétiques, alors qu’en réalité elles l’étaient rarement. Les rencontres énigmatiques avec des personnages au tempérament explosif étaient la norme – des dingues, des dégénérés, des passeurs douteux offrant amulettes, conseils, avis en échange d’un verre, d’un hot-dog ou d’une pièce de monnaie. C’était comme si nous dérivions tous vers une éternité insipide ou rien ne serait plus ni tangible, ni durable. L’atmosphère était certes chargée d’énergie, mais la vie était irréelle. Des nuits entières se volatilisaient dans l’hallucination des néons. Je traversais des événements dont je ne me souvenais que plusieurs jours après – en un éclair soudain, à une croisée incongrue des chemins, et sans liens entre eux – et qui me revenaient tout à coup comme en embuscade. J’étais un pion sur l’échiquier fluide de l’alcool et du désir inassouvi, comme si l’espèce humaine mutait à une vitesse phénoménale et que le jeu lui-même devenait incompréhensible.
Les rues et les bars étaient remplis de types comme Walker Birdsong, toujours plus emphatiques et sermonneurs à mesure qu’ils buvaient. Le jargon rapide et graveleux né dans les bars s’abîmait à une cadence quasi biblique. L’un de ces bardes avançait que des émeutes éclateraient à Los Angeles, La Nouvelle-Orléans et Chicago. Il parlait de volcans, de tremblements de terre et de diables vivants dans l’esprit des hommes. un autre disait que la C.I.A. propageait une nouvelle maladie afin de se débarrasser des pauvres et des homos. Il prétendait qu’une catastrophe majeure allait survenir, qu’il fallait se préparer au pire et qu’il était possible que nous assistions à l’Apocalypse avant de mourir.
Le soir où je sortis du Morrison Café et où je croisai Nick, la lune était suspendue au-dessus de nos têtes, braquée comme la bouche du canon d’un fusil lui-même transformé en lampe-torche. Je connaissais Nick Raven via Tanya. Un de ses ex avait été dans la même chambrée que lui à l’armée. Mais Nick s’était absenté sans permission. On l’avait chassé de l’armée parce qu’il se travestissait de temps en temps pour écumer les bars de Monterey ; ensuite, il avait zoné le long de la côte pendant quelques années. Un jour, il laissa ce mot sur la porte de Tanya : « Tan, j’ai eu ton adresse par Rainwater, à Yakima. Tu te souviens ? Je suis au Hamilton, chambre 22. Viens me voir. Nick. »
Ce mot l’avait rendue quelque peu nerveuse. D’abord, parce qu’Eddie Rainwater était un dealer qui était tombé pour voie de fait après avoir tabassé une de ses meilleures amies – si ce type était sorti de taule, il serait une source d’ennuis ; sa tête n’était qu’une cocotte-minute où les rancœurs bouillonnaient. Ensuite, parce que dans son souvenir, Nick Raven était un déséquilibré en sérieux conflit avec lui-même et une folle à temps partiel qui cherchait les ennuis en invitant les poings des poivrots et des homophobes à s’écraser sur sa figure. Mais Raven avait muselé sa haine de lui-même et on était devenus copains. Cela faisait plus d’un an qu’on l’avait perdu de vue, un peu avant La Nouvelle-Orléans. Et maintenant, voilà qu’il refaisait surface, à peine débarqué de Yakima.
– Frank ! Mon pote !
On se serra la main de manière fraternelle et étudiée, même si la mécanique exacte de cette poignée de main ne me revient pas présentement en mémoire. Je me souviens que Nick avait changé d’allure. Le hippie américain Peau-Rouge s’était métamorphosé en dandy déglingué de l’ère du jazz. Il portait une gapette à la Gatsby, un bouc façon musicien et une veste à rayures et à larges revers. C’était un type imposant, d’un mètre quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quinze pour quatre-vingt-dix kilos.
On s’embarqua pour une tournée dans Burnside, dérivant de bar en bar, ne faisant que quelques haltes occasionnelles pour profiter de repas gratuits. Nick était le guide autoproclamé du repas à l’œil.
– N’importe quelle secte te procurera un repas pour obtenir dix minutes de ton attention, aimait-il à dire.
Les prédateurs sexuels, les maîtres queux et les vieillards solitaires connaissaient tous cette vérité : la nourriture est une forme de propagande – on mangeait certes du pain blanc, mais on avait aussi droit à une ration de symboles. J’avalais les miens sans en être autrement affecté. D’autres personnes, moins sûres d’elles-mêmes, souffraient des conséquences de leur appétit. Et il y en avait à la pelle des prêcheurs prêts à payer au cave un sandwich, voire à lui cuisiner un repas en échange d’un échantillon des charmes de l’affamé. Tout le monde avait quelque chose à offrir. Ce n’était peut-être pas exactement ce dont on avait envie, mais si on connaissait la recette, il devenait impossible de prétendre que notre monde était radin. Et Nick la connaissait.
Pour le prix d’une bière dans un bar de strip-tease, on pouvait obtenir un sandwich au jambon avec du fromage dans du pain de seigle. Il y avait quelques bars à buffet de ce genre aux alentours : Bangers, Boomers, Billy’s Private Eye. Nick expliquait la joie d’un tel repas en matière de spiritualité gnostique, l’équivalence de la corpulence, des privautés sexuelles, de la consommation et de la béatitude. La luxure comme chemin vers la sagesse – ça semblait si facile.
On chantait aussi des chansons d’amour en buvant du soda à la cerise dans une pléthore de fraternités utopiques anesthésiées ; on mangeait des sandwiches au rôti de porc avec la secte Moon et on se délectait de hamburgers froids et de gâteaux rassis à l’Armée du Salut. Plus loin dans la même rue, les Hare Krishna offraient pâtes au grain et sauces sucrées. Au milieu de l’après-midi, on prenait le café et des biscuits à la Maison du Seigneur Compatissant du capitaine Andy. Le capitaine Andy était retraité de la marine marchande ; il avait une jambe en plastique et un œil de verre, et Jésus l’avait guidé à travers bien des tempêtes. Il offrait à présent un peu de sollicitude aux hommes des bas-fonds à l’esprit ravagé par la tourmente. La devise du capitaine était : « Rien n’est gratuit. Même pas la douleur. » Ça n’avait aucun sens, mais il pouvait prouver que c’était vrai – pendant qu’on se restaurait, il sortait son violon et entonnait de vieilles chansons de marins. Si quelqu’un se plaignait que la musique était à chier, il lui disait de la fermer et de bouffer ses biscuits, alors que lui se balançait sur sa chaise, raclant son crincrin tel un Ismaël déraciné, mais en plus dingue, speedé par la caféine et le sucre, et ne vivant pas dans le bon univers.
Carl Watson déploie ici à nouveau son talent rare pour véhiculer ce qui grouille et tente de vivre et survivre dans les bas-fonds du rêve américain (Larry Fondation et Jerry Wilson, par exemple, ne sont de ce point de vue pas si loin). « À contre-courant rêvent les noyés » déploie de surcroît une passionnante vue en coupe de ces lendemains qui déchantent, après l’errance et l’échec des grands mouvements alternatifs et contestataires des années 1960, qu’ils aient été à dominante collective ou individuelle – on pourrait certainement en explorer certains échos du côté de Dana Spiotta (« Eat the Document ») ou de Tommaso Pincio (« Les fleurs du karma ») -, lorsqu’une radicalité de vie se dissout progressivement dans une mélancolie largement déboussolée, soumise à une forte pression de conformation sociale et politique, y compris aux marges de cercles intellectuels relativement « protégés » des pures rigueurs du néo-libéralisme en gestation, car disposant de ressources amicales et familiales non négligeables, quoique frugales, pour organiser leur survie à contre-courant.
Le moment de s’y remettre arriva enfin, après un délai de cinq jours. Nous sanglâmes nos sacs sur nos épaules et partîmes dans la bruine de la fin septembre. Les arbres des Shelley étaient vieux, contrairement à ceux des Hazelton. Ils dataient d’avant l’ère de la biogénétique et de la cueillette scientifique, et ils avaient poussé jusqu’à atteindre une taille gigantesque. Ce genre d’arbre pouvait sembler mature et regorger de fruits vu de loin, mais quand on y regardait de plus près, on apercevait les ravages du temps, l’effritement du tronc, sa récalcitrance à porter des fruits et les coulées de sève desséchées. En contemplant ces hectares plantés d’arbres gigantesques et antédiluviens, on comprenait mieux comment les explorateurs avaient pu mourir ici sans qu’on ne les retrouve jamais : la sensation de danger avait un aspect distrayant. Après tout, il n’y a rien de tel que d’être en équilibre sur une jambe au bout d’une vieille branche cassante avec quinze kilos de pommes autour du cou à chercher en vain dans l’épais feuillage le haut de l’échelle de douze mètres qu’on a quittée il y a si longtemps. Une fois là-haut, on est vite agacé par de toutes petites choses : un oiseau passe en volant délicatement, libre, et on se met à le maudire ; un écureuil vient vous narguer en faisant de l’équilibrisme avec une assurance toute acrobatique, tandis qu’un insecte doté de multiples pattes, legs de la préhistoire, remonte le long de votre main agrippée à une branche. Puis vient le bruit que les cueilleurs craignent le plus. Ça commence lentement, comme un doux craquement qui dure et augmente de volume jusqu’à ce qu’il atteigne l’accès aux centres d’urgence du cerveau. On se prend alors à élaborer des plans de secours, à chercher désespérément une issue. Faut-il balancer le sac et espérer qu’il amortira la chute ? Faut-il sauter en s’imaginant contrôler la chute et l’atterrissage ? Jusqu’à quel point peut-on avoir confiance dans ses réflexes ? Doit-on regagner l’échelle avec précaution ? Ou bien s’en remettre à la grâce divine ?
Avec ce genre d’arbre, remplir un panier peut prendre jusqu’à trois heures. En fin de journée, le cueilleur est épuisé, contusionné, brisé de partout, et il n’a pas gagné grand-chose. C’est une question de chance : on espère faire mieux le lendemain.
Comme il le confiait lors d’une récente rencontre à la librairie Charybde, Carl Watson développe une conscience aiguë de la fragilité des identités de chacune et chacun. « Qui suis-je ? » est bien une question centrale dans toute son œuvre à ce jour (et on reparlera à propos des « Idylles de la complicité », deuxième volet d’une trilogie commencée par ce « À contre-courant rêvent les noyés », prochainement sur ce même blog) – mais plus encore peut-être : « Quels sont les récits, les narrations, qui me donnent corps, cœur et âme ? ». Pour installer pleinement ce registre de la conversation permanente qui tente de répondre, dialogue ou monologue, peu importe au fond, la langue mise en œuvre est encore une fois diabolique, transformant chaque groupe de paragraphes, ou presque, en une nouvelle à part entière, dont la dernière phrase allie le plus souvent poésie subtilement critique et charme politiquement vénéneux. Et c’est ainsi que Carl Watson réconcilie et harmonise des formes littéraires que l’on jurerait, ailleurs, être foncièrement opposées, et nous offre sa contribution majeure, essentielle, à une littérature de beauté et de combat, jusque sur les terrains les plus inattendus.
Au bout d’une nuit passée à boire, nous prenions un petit déjeuner tardif à la Pancake Pantry ou au Bun & Yolk, avant de rentrer. À cette heure-là, la route n’était qu’un défilé intermittent de Jeeps sûres d’elles-mêmes, de breaks timides et de berlines hébétées – la migration des poivrots à l’heure de fermeture des bars. Quand nous n’arrivions pas à nous faire prendre à bord, nous marchions, et si aucune lune ne frémissait dans le ciel froid, nous pouvions carrément dériver loin de la route. Si aucune scierie ne vrombissait en signe de fraternité, telle une usine satanique planquée dans un trou brumeux, nous nous sentions profondément seuls. Nous pouvions alors être tourmentés par de vieux comptes à régler. La plupart du temps, cependant, nous nous faisions ramener, en principe par quelqu’un avec qui on avait picolé quelques heures plus tôt, par un ancien taulard à l’affût, par un type qui bossait près du campement, ou encore par le caissier de la supérette à qui on avait échangé le chèque de paie de la semaine contre de l’argent liquide, ou même par le contremaître de la scierie. Quant à ceux qui passaient sans s’arrêter – ces parents craintifs dans leur berline Chevrolet, ces tarés déguisés dans leur break vert citron -, nous nous demandions qui ils pouvaient être. Mais pas trop longtemps. Comme je le disais, ces routes étaient sombres, bien moins toutefois que l’imagination des gens qui les hantaient.
Hugues Charybde
Carl Watson - A contre-courant rêvent les noyés - éditions Vagabonde
l’acheter ici