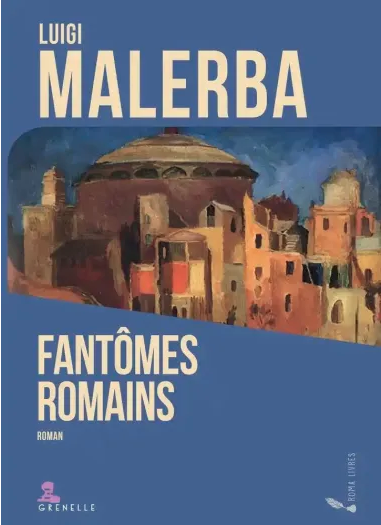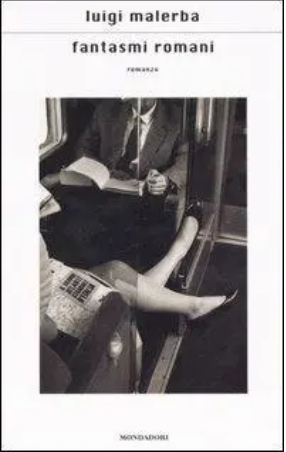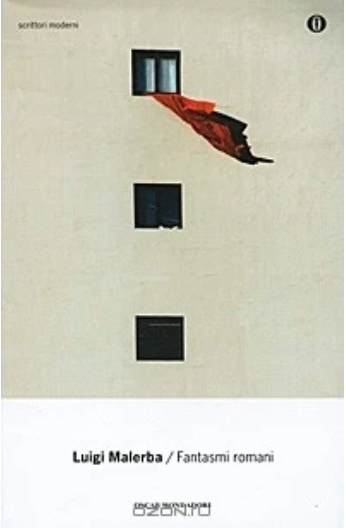Vertige f(r)ictionnel à Rome avec Fantômes romains
Mise en abîme et enchâssement de mensonges indécidables et de vérités fictives : un couple bourgeois universitaire à Rome pour un très savoureux vertige narratif.
Un nid d’aigles sur une haute paroi rocheuse. Un aigle à deux têtes arrive en volant et suscite l’étonnement dans la petite communauté. Finalement, quelqu’un s’approche et lui demande :
« Manipulation génétique ? »
« Non, Habsbourg ».
Cette petite histoire, si nue et si crue, m’a été racontée par Johannes Westerhoff, un ami journaliste du Frankfurter Allgemeine venu en Italie, à Spolète, assister à un congrès sur les biotechnologies pour son journal, et hébergé pendant deux jours dans notre maison de campagne de Casole, près de Todi. Avant de rentrer en Allemagne, il nous a dit en plaisantant qu’il nous offrait l’histoire en exclusivité.
Depuis ce moment-là, Giano ne perd jamais une occasion de proposer à nos amis l’histoire de l’aigle à deux têtes, qui a du succès pour deux raisons : elle cite un sujet scientifique à la mode et elle chatouille le snobisme historique de l’auditoire. Chaque fois qu’il la raconte, Giano introduit une variante, pas tant dans le schéma narratif, qui est simple et immuable, que dans les éléments du décor. Par exemple, la pluie. Ceux qui écoutent s’attendent naturellement à un retournement de situation en rapport avec la pluie, alors que la chute surgit, sèche comme un coup de fouet.
Avec le temps, Giano s’est rendu compte qu’à cette altitude, la neige est plus logique que la pluie, alors il y a introduit la neige. Certaines fois, il raconte que l’aigle est fatigué (nous ne savons pas encore qu’il a deux têtes, car, dans le récit, il vole au loin), parce qu’il arrive d’un pays lointain (l’Autriche ?). Giano dit que le secret consiste à créer une attente différente de celle qui conclut le bref récit : la « péripétie », selon Aristote, c’est-à-dire le déroulement d’une scène à l’inverse de ce qui est prévu. De la manipulation génétique à Aristote pour aboutir à une blague (mais Giano m’a interdit de l’appeler blague).
Quatre jours après son départ, nous avons appris la mort de notre ami allemand dans un accident de voiture, sur la route entre Francfort, où il habitait, et Duisbourg, où il allait donner une conférence d’information sur le déroulement du congrès de Spolète, à l’austère Université qui porte le nom de Gerhard Mercator. Consternation absolue à l’annonce de cette mort trop bête, comme toutes les morts sur la route. Pauvre Johannes, mourir après avoir foulé la surface de la terre pendant quarante-sept ans seulement. Précisément à la période la plus intense de son activité et de son succès professionnel. Nous avons envoyé un télégramme, puis un petit mot, à son épouse, que nous savions dévastée.
Combien de temps dure le chagrin pour la mort d’un ami ? Ce sympathique journaliste allemand était plus une connaissance qu’un véritable ami, mais sa mort nous a pris par surprise et nous n’avons pas fait de commentaire, car le silence nous semblait être la meilleure expression de notre douleur. La mort l’avait promu au rang d’ami.
Giano a continué à raconter la petite histoire de l’aigle à deux têtes, avec un sentiment inconscient de gêne puisque sa source s’était évaporée avec la mort. J’écoutais Giano qui paradait encore avec l’aigle à deux têtes et je sentais que l’atmosphère avait changé, il y avait dans mes oreilles la mort bruyante du pauvre Johannes, un fracas de tôles sur l’asphalte nocturne et la voix désespérée d’un homme à l’agonie. J’aurais voulu dire à Giano d’abandonner l’aigle à deux têtes, mais je craignais de le vexer en ayant l’air de lui reprocher son manque de sensibilité. Giano a encore raconté cette histoire à trois ou quatre occasions et, chaque fois, sous ses mots, j’entendais ce lointain fracas de tôles sur la route entre Duisbourg et Francfort. Mais j’ai fait mine de m’amuser, comme d’habitude, pour ne pas le froisser.
« Fantômes romains » (dont le titre français ne peut pas refléter l’ambiguïté fondamentale du « fantasma » italien, à la fois spectre et fantasme) raconte l’histoire d’abord presque banale d’un couple romain : lui, Gianantonio (que son épouse appelle du charmant diminutif Giano, désormais repris par toutes et tous parmi leurs connaissances communes), professeur d’architecture et d’urbanisme, célébré dans le monde universitaire et artistique pour ses audaces, et elle, Clarissa. Tous deux, chacun de leur côté, nous confient les doucereux heurs et malheurs de leur couple classique et bourgeois, d’une apparente et exemplaire solidité forçant l’admiration de leurs cercles amicaux communs et respectifs, mais reposant, derrière le décor, sur une formidable accumulation de mensonges et d’hypocrisies, au quotidien comme au beaucoup moins quotidien.
En une hilarante et glaçante narration alternée, nous assistons à l’évolution simultanément tragique et comique de ces deux Janus (nous proposant donc au moins quatre faces), tandis que, l’écriture fictionnelle d’un roman se mêlant aux journaux intimes dérobés à l’autre, les amabiguïtés et les quiproquos se multiplient, la mince frontière séparant la vérité du mensonge comme le réel de la fiction se fragilise, et les dénouements probables et improbables s’amoncellent à l’horizon du récit croisé.
Idiote, triple idiote. Va savoir pourquoi Valeria a dit à Clarissa qu’elle connaissait l’histoire de l’aigle à deux têtes. Elle est tombée dans un vulgaire piège, cette idiote. Et pourquoi diable lui a-t-elle dit que c’était l’agent de la Deutsche Bank qui la lui a racontée ? La deuxième bêtise, lui ai-je expliqué, est pire que la première parce qu’elle rappelle inutilement l’origine allemande de l’histoire, et surtout parce que l’agent de la banque allemande existe vraiment, qu’il a lui aussi une maison près de Todi et que Clarissa peut facilement le retrouver. Dans ce cas, je serais vraiment dans de beaux draps, mais, par chance, je peux compter sur la paresse de ma femme, et peut-être sur son désir de ne pas savoir ce qu’elle sait déjà, si je fréquente ou pas Valeria.
Clarissa ne m’a pas parlé de sa rencontre avec Valeria à l’Académie de France, mais, depuis qu’elle a compris que c’est moi qui lui ai raconté l’histoire de l’aigle à deux têtes, elle me met sous pression avec de fausses marques de jalousie qui peuvent toutefois passer pour des signes d’affection véritable. Il s’agit d’exercices de mauvaise foi, une représentation de notre petit théâtre conjugal, au fond, un exercice d’amour.
Quand je donne mes cours à l’Université, je laisse mon portable éteint, alors elle m’envoie de courts messages. « Appelle-moi après ton cours ». Si je ne la rappelle pas après mon cours, elle me harcèle quand je rentre. « Pourquoi est-ce que tu n’as pas rappelé ? », « Où es-tu allé ? », « Tu es allé voir quelqu’un ? », « Il y a une étudiante dans les parages ? ». Clarissa prend l’expression malicieuse de celle qui a tout compris, mais qui m’a déjà pardonné. La vérité est plus simple : Clarissa est très intelligente et elle a compris qu’il n’y a rien à chercher du côté des étudiantes. C’est aussi pour ces fictions généreuses que je l’aime. Quel ennui, sans Clarissa.
« Mais quelle étudiante, quels parages, arrête un peu ! ». Je sais qu’il s’agit d’une de ses mises en scène pour éviter les vrais sujets qu’aucun de nous ne veut affronter, aucun de nous ne veut ouvrir la porte aux Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. Moi, je réponds distraitement, ce qui est le moyen le plus simple d’anéantir sa fausse jalousie qui cache peut-être, va savoir, une vraie jalousie. Nous avons toujours vécu dans le faux-semblant et ça nous convient, ça nous arrange tous les deux, jusqu’au jour où cette maudite histoire a obligé Clarissa à avoir des soupçons sur mes rendez-vous secrets avec Valeria. Je crois vraiment qu’il y a eu un temps où Clarissa savait déjà, mais où elle faisait semblant de ne pas savoir. À présent elle ne peut plus feindre comme avant, ce qui signifie qu’elle a changé de registre dans la fiction qu’elle joue. Clarissa sait très bien que Valeria ne laisse jamais filer une occasion et que, si nous nous sommes donné rendez-vous une fois, la suite est aussi certaine que deux et deux font quatre.
Publié en 2006, traduit en 2021 par Lucie Comparini (qui coordonnait pour cela le travail du Laboratoire de Traduction « Passages » de l’UFR d’études italiennes de Sorbonne Université) aux éditions Grenelle, « Fantômes romains » est l’ultime roman de Luigi Malerba, concluant ainsi deux ans avant son décès une riche et longue carrière de scénariste, de réalisateur et d’écrivain célébré (parmi ses seize romans, on pourrait rappeler par exemple « Le Serpent cannibale » en 1966, « Le Saut de la mort » en 1970, qui obtint le premier prix Médicis étranger décerné, « Les Pierres volantes » en 1992, couronné par le prix Viareggio, ou « Ithaque pour toujours » en 1997, dans lequel le dialogue entre Pénélope et Ulysse anticipait à plus d’un titre celui, ci, entre Clarissa et Giano).
Comptant parmi les fondateurs, avec Nanni Balestrini, Giorgio Manganelli ou Umberto Eco, du Gruppo 63, cercle d’avant-garde s’il en fut, marxisant, structuraliste et hautement expérimental, l’auteur nous prouve ici à quel point il sut maintenir et amplifier, contre vents et marées littéraires (avec leurs « effets de mode »), une approche suprêmement ironique de démontage / remontage du roman psychologique traditionnel, jouant à merveille de complications (quasiment au sens mis en avant en 2011 par Nina Allan), et sachant ici aller beaucoup plus loin dans la mise en abîme et le vertige savoureux (autour du prétexte en or que peut constituer le « couple bourgeois » à inscription universitaire) que, par exemple, l’illustre David Lodge de « Changement de décor » (1975) ou de « Un tout petit monde » (1984). Usant avec une folle élégance des intrications rendues possibles par la création de niveaux de fiction enchâssés à la limite de l’indécidable, il nous offrait ici, en moins de 250 pages, une dernière réalisation presque monumentale, qui mériterait d’être bien davantage connue chez nous.
Voilà pourtant que l’histoire de l’aigle à deux têtes s’est fichée comme un clou dans l’équilibre imparfait sur lequel repose notre mariage. J’ai dit « imparfait » volontairement, parce que nous évitons, aussi bien Giano que moi, de fouiller dans les secrets et les clous que chacun de nous garde précieusement en lui et qui, s’ils remontaient à la surface, pourraient provoquer une catastrophe. Le mensonge est notre salut. Simple manutention du mariage. Parfois je me mens aussi à moi-même, c’est presque un exercice de yoga qui me soulage de la présence rugueuse et oppressante de la réalité.
Par exemple, j’ai tout fait pour effacer de ma mémoire une liaison entre Giano et Patricia, la veuve insatiable d’un de ses collègues, qui conservait un certain nombre de dessins et de documents de son mari. Elle voulait savoir s’il était possible de les publier quelque part, par exemple dans la revue Diagonale éditée par la Faculté d’Architecture, et si Giano pouvait, au moins, l’aider à les cataloguer. Giano se plaignait auprès de moi de cette enquiquineuse, mais il ne pouvait pas dire non à la pauvre veuve. Sauf qu’entre-temps, la pauvre Patricia l’a mis dans son lit, comme je l’ai ensuite appris par une amie qui avait recueilli les confidences de cette salope. Deux mois de sexe l’après-midi, de quinze à dix-sept heures. Encore deux autres mois, non plus à la bibliothèque du Palazzo Venezia, mais de nouveau chez Patricia, piazza dei Mercanti, dans le quartier de Trastevere, au troisième étage d’un bâtiment ancien particulièrement délabré. Des cornes quotidiennes, une véritable corne d’abondance sexuelle. Qui sait, tout pourrait être inventé, c’est peut-être un perfide commérage. « Ne fouille pas, me suis-je dit, laisse les choses aller comme elles vont, c’est-à-dire plutôt mal ».
Hugues Charybde, le 9/10/2023
Luigi Malerba - Fantômes romains - éditions Grenelle
L’acheter chez Charybde ici