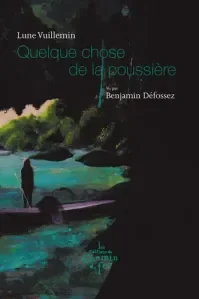Quelque chose de la poussière de Lune Vuillemin (balaye la famille)
Nature sauvage et hantée, cercle familial rapporté et bizarre, quête imprécise et fabuleuse : un extraordinaire roman court de l’intime transfiguré en drame aussi séculaire que spécifique.
On marche toute la nuit, la vieille ne veut pas parler. Lorsqu’elle sent que je vais briser son silence, elle siffle. Comme les serpents. La nuit, moi, ça m’angoisse. Dans le bois, surtout. Les arbres se changent en ourses aux ongles longs qui marchent sur nos pas. Ce sont des masses noires aux museaux humides et fumants. Je me tords la cheville sur quelques branches et quand j’ai trop peur je caresse ma boîte d’allumettes. Si une de nous meurt un jour en forêt, ce sera moi. La vieille a ses esprits qui la protègent. Dans le bois, surtout, elle leur parle tout bas. Mais je l’entends, j’ai compris, c’est bien pour ça qu’elle veut mon silence. Qu’elle veut le silence de tout. Elle pleure aussi, elle renifle et s’essuie les joues avec le poing. Je ne sais pas comment elle fait pour pleurer la nuit dans le bois, on dit que les larmes attirent les couguars orphelins. Ceux qui cherchent leurs mères, qui savent le goût de l’abandon.
Pas étonnant qu’on lui ait donné le nom d’un arbre qui pleure.
Lorsqu’on entend l’océan, c’est un grand soulagement. Au-dessus de l’eau : la lumière de la lune, fatiguée et fade, derrière les immenses pins. Encore un jour prêt à se lever. Les vagues se jettent désespérément sur la plage, elles sont belles quand elles se retirent. Il n’y a rien que le calme et nos peurs. J’inspire profondément l’iode et l’air qui goûte le large. La vieille ramasse du bois flotté, je la regarde se pencher. J’ai envie de grimper sur son dos, faire craquer ses vertèbres capricieuses. Elle devient toute petite tellement elle se penche sur les choses, sur les gens, sur la plage. Elle étreint les troncs d’arbres morts comme si ça ressentait la tendresse un tronc d’arbre mort, comme si ça avait du sens. Je n’ai plus le goût de dormir, d’ailleurs la lune déchante. Quelques mouettes cassent l’horizon et viennent brailler au-dessus de nous. J’ai froid et mon dos frissonne. Il faut faire du feu et préparer le café, il faut qu’il soit fort, qu’il soit noir. L’eau est froide, pourtant la vieille se déshabille et marche lentement vers elle. Le ciel est violet, bleu aussi. Les corbeaux se réveillent au-dessus de la vieille. J’imagine le sel qui dégouline dans les ravins de ses rides qui contournent ses gros seins en forme de goutte de pluie. J’imagine qu’elle sourit, maintenant que personne ne la voit. Elle se donne entière à l’océan, ses cuisses molles claquent comme des portes. On doit se sentir jeune dans les vagues du matin, et la vie doit perdre son sens. J’aimerais peut-être qu’elle ne revienne pas, qu’elle reste dans l’eau, qu’elle se change en phoque à la peau lisse, même si j’ai peur de retourner dans le bois toute seule. La marée ramène à terre toutes sortes de trésors venus du continent. Une chaussure, des bouteilles et des canettes de bière où sont mortes des balanes. Il n’en reste que leur volcan poreux que j’aime caresser du bout des doigts. Des filets de pêche abandonnés et des contenants en plastique. Les ratons laveurs s’aventurent sur la plage à coups de griffes, leurs queues hésitantes balayent le sable et le café est prêt. Un pygargue survole notre déjeuner, j’enfonce mes orteils profondément dans le sable. La vieille bâille doucement et ses yeux bleus semblent fragiles comme des fossiles. Une légère brume s’installe sur la cime des arbres quand enfin elle ferme les paupières. J’aime quand elle dort, mais ça ne dure jamais longtemps. Je regarde le duvet gris au-dessus de sa lèvre, celle qui disparaît. Je regarde ses rêves agités dans le froncement de ses sourcils. Je regarde ses doigts qui tremblent sous une joue écrasée. Je regarde un grain de sable sur son menton. Je regarde la vieille qui dort. Elle ressemble à un monstre marin, qui somnole dans des eaux sombres. Il fait encore froid et je sais qu’il nous faudra nous émanciper de l’océan. Je sais qu’il nous faudra affronter la terre. Nous sommes venues dire au revoir au jour qui pointe sur notre plage.
C’est une nouvelle terre pour nous, quelque chose de la poussière et de l’absence de sel. Pourtant, vite retrouver les étendues de pins majestueux, les trembles fins et gracieux et le passage des cervidés sur la route. La neige nous attendra bientôt, et notre silence est accablant de douleur. Nous perdrons la tête, c’est sûr. Nous ne sommes pas prêtes pour le monde. La vieille s’arrête sur le bord pour uriner et j’aimerais me glisser à sa place, empoigner le volant et démarrer en trombes. Partir sans elle, la laisser penaude dans le fossé. Mais je sais qu’elle gardera son calme et qu’elle me retrouvera.
Il n’y a plus d’océan, c’est la terre des grands lacs qui sont pour nous comme de misérables flaques d’eau. Des buses se retournent sur notre passage, et bientôt : les hommes forts qui coupent les arbres dans leurs bottes à cap d’acier. La vieille me tire par la manche. Abandonné le pick-up dans la boue du chemin, seuls les grumiers ont le droit de passage. On est bien plus libre à pied. L’un des bûcherons nous insulte, nous apostrophe, nous traite de chair fraîche. La vieille fait semblant de rire et je lui fais voir mon plus beau doigt d’honneur. Je ne suis pas de la pâtée pour chat sauvage, monsieur. Je suis en colère parce que j’ai peur. Parce que la vieille m’entraîne toujours dans les bois à la tombée du jour, et qu’elle ne peut plus me défendre. J’aurais voulu qu’on reste dans nos bois sauvages, ceux dans la maison qui n’existe plus ou ceux autour que nous connaissons si bien.
Je sens comme une respiration chaude qui nous enveloppe, des esprits sans doute appelés par la vieille pour nous guider. La voilà qui s’immobilise devant moi. La vieille fait volte face. La vieille a peur. Je comprends, derrière nous.
Peut-être l’animal nous suit depuis les roues du pick-up embourbées dans la gadoue. C’est un couguar, il est beau et je ne peux regarder que sa gueule brune massive. Il a le regard sévère. On dit qu’il ne faut jamais tourner le dos à un couguar, qu’il vous écrase les omoplates à l’instant même où vous pensez vous retourner pour courir. Que les os tremblent, et qu’on ne sent rien. La vieille déjà se calme. Elle cherche à s’asseoir à terre et je sais que la fuite n’est pas envisageable. Plier les genoux devant l’animal ? Se soumettre ? Je ne sais pas quoi faire devant le ventre chaud et les pattes extraordinaires qui se dressent devant moi. C’est une femelle, une mère qui arpente la montagne, les mamelons gorgés de lait.
Je ne sais plus qui regarder, la vieille ou le sol, la mâchoire ou la queue. Sent-on comment on meurt si l’on s’endort avant ? Je comprends derrière mes oreilles et un peu au-dessus comme des dents peuvent serrer très fort. Pourtant sa gueule est bien fermée, droite. La vieille porte son menton haut comme une tour, et je décide de lever la tête. Me tenir droite, moi aussi, comme les deux autres qui m’entourent. Je déroule ma colonne, elles le voient tout de suite, tous les yeux sont sur moi. J’ai le dos droit mais pas de mur pour m’y adosser, et ça ne dure pas. Je n’ai pas l’étoffe d’un prédateur, mes vertèbres ne tiennent pas dans leur verticalité.
Comment fait-elle, avec son squelette qui a vécu des centaines d’années, pour ignorer la fourmilière dans ses mollets ? Je prends appui sur mes coudes, ils sont fragiles. Je vais chercher de l’air dans les recoins de mon corps, c’est hésitant. Au moment très précis où l’angoisse est née, le couguar tourne un peu son museau vers moi. Et la vieille de relâcher la pression. Son dos se courbe un peu, je sais qu’elle va bientôt pouvoir dormir. Ma peur va nourrir la bête, elle s’en léchera les babines. La vieille m’abandonne dans l’éveil. Il n’y a plus que l’animal et moi. Je voudrais pleurer, j’ai chaud sous les bras et dans le bas du dos. J’aimerais qu’un chasseur perdu apparaisse derrière moi et m’enlace. Mais personne ne vient, la vieille s’endort et je pleure. Peut-être cette nuit, je mourrai dans les bras du couguar.
Publié en 2019, le premier roman (court, 87 pages) de Lune Vuillemin est magnifiquement rehaussé par les illustrations de Benjamin Défossez, dans le cadre de ce dialogue permanent entre littérature et arts plastiques que pratiquent les éditions du Chemin de Fer (on garde par exemple encore un souvenir puissant, intact et ému, du « Tryggve Kottar » de Benjamin Haegel illustré par Marie Boralevi).
Si son décor évoque d’abord les confins sauvages familiers aux lectrices et aux lecteurs de David Vann ou de Pete Fromm, mais aussi à celles et ceux de Bérengère Cournut, pour cette capacité à y saisir une intimité évoluant sous contraintes rituelles et (quasiment) cosmogoniques, « Quelque chose de la poussière » dévoile rapidement, puis plus sourdement et secrètement, ses propres miracles. Lune Vuillemin, s’appuyant sur les méandres secrets évoluant à l’intérieur des crânes humains comme sur les sentiers cachés au cœur des forêts et des taillis, invente sa propre langue et sa propre tonalité. Joliment retorse face aux attentes créées par les premiers jalons qu’elle dissémine avec précision dans sa narration croisée, elle manie avec un sauvage entrain les silex à frapper pour donner naissance à d’éventuels feux ravageurs, comme à des braises et à des cendres subtilement inattendues. Et c’est ainsi que naît chez nous l’impression de plus en plus tenace d’assister ici à la naissance d’une grande écriture.
En arrivant au bord du lac, les filles se tressent les cheveux. La blonde saute dans la benne et fait glisser le canot vers la bleue qui transpire déjà. Ses joues se gonflent et luisent mais elle est aussi athlétique que l’autre. Je roule une cigarette, l’air est humide et trempe le tabac, le transformant en algue noire. Le canot en frêne était celui de ton père. Ce grand-père que je n’ai jamais connu. Tu me parlais de ses mains formidables et des veines sur son front qui saillaient lorsqu’il jouait de l’harmonica. L’odeur de tabac à pipe, de ses bottes crottées, du café de chaga et du canot. Lorsque tu as eu treize ans, il t’a choisie toi, l’aînée de ses deux filles pour être celle qui chasserait le castor.
Tu ne m’as jamais raconté ce premier jour au lac, mais je me souviens du mien. Mon initiation au piège à ressort, il pleuvait aussi, tu avais disparu sous ta capuche et m’apprenais des nœuds. Nous savions où étaient les huttes, passions des journées entières à faire le tour du lac à la recherche de coulées. Il suffisait de poser les pièges devant une entrée de hutte, et revenir quelques jours plus tard. On retrouvait les bouées plus loin, où personne n’a pied. Les castors mouraient sur le coup, entraînés par la bouée. Je regardais tes doigts et la corde qui relierait le piège à la bouée jaune. En voyant la grosse bague de métal couler dans l’eau noire, j’ai pensé à mon propre corps et mes os en miettes dans la mâchoire du piège. Pour la première fois, j’ai pensé à ma mort.
“Maintenant, rejoins l’autre rive, nous allons voir si un castor a mordu”, m’avais-tu dit.
Je pagayais timidement et lentement, faisant des zigzags pour retarder notre arrivée au niveau de l’autre bouée. Et j’ai su, quand tu as tenté de la soulever, qu’un castor avait mordu.
C’est ta petite-fille qui s’occupe du lac désormais. À bord du canot de grand-père, elle pagaie le dos bien droit, avec agilité et vitesse. Je reste à terre, je n’ai plus l’âme à initier qui que ce soit. Dans mes jumelles, je vois les joues rondes de la bleue, si belle sur le lac, entourée des Douglas majestueux et sombres. J’aurais aimé qu’elle soit ma fille, pour ses épaules musclées et son silence. Pour qu’elle me porte sur son dos et se taise, pour que jamais je ne cesse de partir en forêt. Sa présence ne me gêne pas, avec elle je suis seule. Elle n’a aucune énergie, aucun charisme. Ma fille, elle, scintille et cogne. Son corps s’impose dans l’espace et prend toute la place. Marcher en forêt avec elle c’est épuiser les prédateurs, faire fuir les insectes et assécher les ruisseaux.
Là voilà déjà qui tire sur la corde. L’animal doit être lourd, mort noyé. La blonde hisse la carcasse trempée à bord. Le cœur de la bleue bat dans ses joues. Je regarde la blonde et j’imagine qu’elle lui explique ce qu’on en fera. Soudain, la bleue lui saute à la gueule. Le canot manque de se retourner, la bleue serre ses mains autour du cou de la blonde. Ma fille ne panique pas, je la vois tenter d’inspirer le plus d’air dont elle est capable. Elle sait survivre. La bleue lâche prise, la gifle et hurle comme une louve. Une joue rouge et une joue blanche, ma blonde déboussolée sous la poigne de la géante. Les deux se lèvent et à leurs pieds gît le mammifère trempé de vase. La bleue mord la blonde à l’épaule. La blonde en croche-pied et l’autre qui tombe dans le canot qui tangue de plus en plus. Un coup de poing fend l’air, j’entends un cri. La bleue soudain, le nez écarlate, plonge dans le lac et disparaît.
Un plongeon huard pousse sa longue plainte. La blonde paraît si petite sur le lac, insignifiante. Elle sursaute dans la brume en entendant la bleue reprendre son souffle derrière elle. Elle attrape une pagaie et menace de la frapper au crâne. Sans attendre, la bleue se hisse sur le canot de tout son poids et, lentement, fait pencher l’embarcation. Elle s’arrêtera à temps, je le sais. Ce n’est qu’un jeu. Ce ne sont que des enfants. Une dispute entre sœurs. Mais elle ne s’arrête pas, la blonde hurle. La barque se referme sur les deux filles comme une bouche. Je pousse un cri, moi aussi, mais aucun son ne sort de ma gorge sèche. Ma voix semble s’être évanouie elle aussi dans les eaux troubles du lac. Mon cri dans les profondeurs, et l’image de leurs corps lourds qui luttent. La blonde, la bleue et le castor.
Elle ne sait pas nager.
Hugues Charybde, le 16/12/2025
Lune Vuillemin et Benjamoin de Fossez - Quelque chose de la poussière - éditions Chemin de Fer
l’acheter chez Charybde, ici
lune-vuillemin-2023-credits-seb-germain