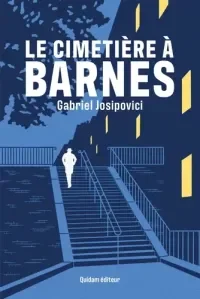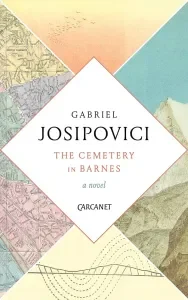Monteverdi et Du Bellay, un voyage au cimetière avec Gabriel Josipovici
Machiavélique et poétique, une ritournelle pour célébrer l’amour et tromper la douleur, sous le double signe de l’Orphée de Monteverdi et des Regrets de Du Bellay. Un somptueux roman court.
Il vivait à Paris depuis longtemps. Trop longtemps pour s’en souvenir, disait-il.
Après la mort de ma première femme, expliquait-il, je n’avais plus aucune raison de rester en Angleterre. Il décida alors de s’installer à Paris et de gagner sa vie comme traducteur.
La beauté du métier de traducteur, disait-il, c’est que vous pouvez le faire n’importe où et vous n’avez jamais besoin de rencontrer votre employeur. Lorsque la traduction est terminée, vous l’envoyez et, au moment venu, vous touchez le reste de vos honoraires. Entre-temps, vous avez commencé à traduire le prochain livre.
Il était de la vieille école et mettait toujours une veste et une cravate avant de s’installer à son bureau, et un manteau et un chapeau pour sortir. Même au plus fort de l’été parisien, il ne sortait jamais sans son chapeau. À mon âge, disait-il, il est trop tard pour changer. Et puis, j’ai mes petites habitudes, j’ai toujours été comme ça.
Il vivait dans un petit appartement au dernier étage d’un immeuble décrépi de la rue Lucrèce, derrière le Panthéon. Pour y accéder, il fallait emprunter la rue Saint-Julien, étroite et sombre, et gravir les escaliers raides qui débouchent juste en face de l’immeuble. Bien sûr, on pouvait l’atteindre par d’autres chemins, mais c’est celui qu’il avait l’habitude de prendre. Dans son esprit, c’était par là que son petit appartement était relié au monde extérieur.
Depuis son bureau, s’il tendait le cou, il pouvait apercevoir le bord du grand dôme du Panthéon à travers la lucarne. Tous les matins, été comme hiver, il se levait à six heures, jetait un rapide coup d’œil pour s’assurer que le monstre était toujours là, se rasait, s’habillait, préparait un petit déjeuner léger et se mettait au travail à sept heures quinze. Il travaillait jusqu’à onze heures, après quoi il mettait son chapeau et son manteau et descendait dans le monde d’en bas. Il s’arrêtait au coin de la rue pour prendre un café, faisait les quelques courses dont il avait besoin, achetait son journal, puis mangeait un sandwich et buvait une bière dans un café voisin. À treize heures trente, il était de retour à son bureau où il travaillait jusqu’à seize heures, après quoi il avait terminé sa journée.
C’était le moment qu’il attendait avec le plus d’impatience. Il prenait la petite boîte en bois estampillée d’un dragon rouge où il conservait son stock de thé à longues feuilles Ceylan Orange Pekoe spécialement importé et suivait un rituel très précis : il chauffait la théière, y plaçait les feuilles de thé pour qu’elles se déploient dans la chaleur de son ventre et après avoir versé l’eau bouillante, il laissait infuser le thé le temps qu’il fallait. Après avoir bu son thé, au printemps et en été, il partait se promener dans la ville. Parfois, cela le menait jusqu’à la Seine, à d’autres moments jusqu’au jardin du Luxembourg ou même jusqu’au cimetière du Montparnasse, autrefois connu sous le nom de Cimetière du sud, où Baudelaire est enterré. S’il se sentait particulièrement en forme ou aventureux, il traversait le fleuve, remontait la rue du Temple et déambulait dans le quartier juif, ou bien il prenait un bus jusqu’à Pigalle puis descendait la rue des Martyrs et le boulevard Montmartre, empruntait les passages couverts et débouchait dans les jardins du Palais Royal, avant de se retrouver au Louvre et de nouveau près de la Seine. De temps en temps, le dimanche, il prenait le métro jusqu’au marché aux puces de la porte de Clignancourt et se promenait dans ce bidonville étrange et irréel où l’on pouvait acheter de tout : vestes en cuir, abat-jour art déco, énormes tables de cuisine qui avaient trôné pendant des siècles dans des fermes de la campagne normande, robes de cérémonie d’anciens rois africains. C’est aussi là qu’un jour, il avait aperçu Benjamin Britten et Peter Pears en train d’examiner un grand lingam en pierre calcaire verte.
Il est traducteur du français vers l’anglais, traducteur littéraire de préférence, mais acceptant parfois des travaux un peu plus « alimentaires » lorsque nécessaire. Veuf de sa première épouse (dont on n’apprendra les circonstances de la disparition que loin, déjà, dans le parcours mémoriel subtil, en boucles sérielles et faussement répétitives, que constitue le roman), il vit avec la deuxième dans une ferme rénovée, proposant une vue superbe, au milieu des collines du Pays de Galles. Les remémorations qui parsèment volontiers les dîners amicaux que le couple propose fréquemment à ses amis se concentrent d’abord et longtemps, dans ce qui nous en est livré ici, sur le séjour solitaire effectué à Paris, durant plusieurs années, après la mort de sa première femme et avant la rencontre avec la deuxième.
Il faudra apprivoiser ces boucles de souvenirs aux éventuelles trompeuses apparences infra-ordinaires pour discerner ce qui se joue dans l’usage presque ritualisé de certains leitmotivs et dans la trame distraitement étrange de certaines obsessions, celles de la noyade et de la submersion, ou de la pérégrination et de la musique classique et baroque, mais aussi celles, beaucoup plus spécifiques (et se révélant infiniment rusées à l’issue de la lecture), attachées aux « Regrets » de Joachim du Bellay et à l’« Orfeo » de Claudio Monteverdi, pour pénétrer la confusion et l’ambiguïté dissimulées en pleine vue par la répétition, pour saisir pleinement ce dont il retourne ici, ce que peut signifier un certain cimetière, si modeste, et comment Gabriel Josipovici, une fois de plus, est parvenu à transformer le faussement anodin en épopée intime et artistique, au premier rang de laquelle triomphent, à leur manière bien particulière, l’amour – en ses différentes traductions -, et une version hautement travaillée d’un possible et quasiment secret sens de la vie.
Parfois, tu allais aussi au concert l’interrompait sa femme – sa seconde femme. Et il semblait avoir besoin de ces interruptions qu’il intégrait habilement à son discours, s’en servant comme de tremplins pour développer son thème.
En effet, poursuivait-il, mais pas souvent ; les concerts étaient onéreux et après Londres, ceux de Paris étaient presque toujours décevants.
Nous écoutons beaucoup de musique ici aussi, disait sa femme, pointant du doigt la collection de vinyles sur les étagères. Quand des amis venaient chez eux pour le week-end ou quand des voisins passaient les voir dans leur ferme aménagée des Black Mountains, sur les hauteurs d’Abergavenny, le soir, ils leur faisaient écouter de la musique baroque sur leur chaîne hi-fi d’excellente qualité. Son épouse, une belle femme dont l’imposante chevelure rousse était remontée sur le haut de la tête, lui tendait les disques respectueusement, les époussetant au passage avec un chiffon spécial, mais elle lui laissait faire les derniers gestes : poser le vinyle sur la platine, mettre en route le mécanisme, abaisser l’aiguille en douceur, fermer le couvercle.
Je suis tellement inculte, disait-elle. Quand je l’ai rencontré, je pensais qu’une sarabande était quelque chose que l’on porte autour de la taille.
Tu avais d’autres qualités, disait-il en souriant.
Mais pas celle d’apprécier la musique classique, disait-elle.
Entre deux vinyles, il parlait souvent de ses années parisiennes. Après la mort de sa première femme, disait-il, il avait surtout eu besoin de solitude. Non pas qu’il voulait ressasser ce qui s’était passé, il voulait juste être seul. J’ai sans doute accepté plus de travail que le strict nécessaire, disait-il, mais je pense que j’avais besoin de savoir que lorsqu’un livre était fini, un autre m’attendait, puis encore un autre.
Parfois, au printemps et en été, quand la lumière du petit matin touchait de sa douceur extrême le ventre arrondi de la théière en terre cuite vernissée, il était envahi par une sensation extraordinaire de paix et de bien-être.
Je n’aurais jamais connu de tels moments si je n’avais pas été seul, disait-il. Et, en fin de compte, voyez-vous, ce sont ces moments que l’on chérit et dont on se souvient.
Publié en 2018, traduit en français en 2025 chez Quidam Éditeur par Vanessa Guignery, le dix-neuvième roman (si l’on compte pour deux la double novella « After & Making Mistakes », non traduite en français, et si l’on ignore bien sûr dans ce décompte les cinq recueils de nouvelles publiés depuis « Mobius the Stripper » en 1974) de Gabriel Josipovici poursuit le cheminement inspiré qui est le sien, créant à chaque occurrence l’exacte écriture nécessaire à son propos subtil, de la musique éminemment classique de « Goldberg : Variations » (2002) à celle plus nettement contemporaine de « Infini – L’histoire d’un moment » (2012), du bourdonnement de la conversation de « Moo Pak » (1994) au presque silence de « Tout passe » (2006), pour ne citer que quelques-unes de ces mélodies, chaque fois ad hoc et pourtant chaque fois magnifiquement reconnaissables.
Tout en scansions et en rituels dont on découvrira le moment venu la part profondément conjuratoire (à l’écart de tout mysticisme, il y a pourtant une nette part de sorcellerie athée, qui passe d’abord par la musique et par la langue, à l’œuvre chez les narrateurs toujours aussi peu fiables de Gabriel Josipovici), « Le cimetière à Barnes » préserve longtemps (à l’échelle de ses 110 pages) son mystère et son brouillard fumigène d’autant plus efficace qu’il affecte – après tout – une transparence fort bonhomme. Comme il nous l’avait montré dès 1993 avec « Dans le jardin d’un hôtel » (et « Contre-Jour », en 1984, n’en contenait-il pas déjà bien des traces ?), l’auteur excelle à cacher l’ombre redoutable de l’Histoire (qui peut prendre la forme plus délicate de l’Art) dans le secret du faussement anodin : ce n’est qu’au détour d’une répétition tranquille qu’un détail, par ci par là, semblera, peu à peu, échapper à la maîtrise langoureuse et au contrôle tatillon développés par le protagoniste principal – avec la complicité enjouée (et n’en pensant peut-être pas moins) de sa deuxième épouse. Il faut une mécanique complexe de la mémoire et de la conversation, lorsqu’on ne dispose pas des boîtes extraordinaires de Joseph Cornell dans « Hotel Andromeda » (2014), pour tenir à distance, juste ce qu’il faut, la douleur et l’horreur. « Le cimetière à Barnes » nous en concocte une méthode unique, malicieuse et mélancolique, joueuse et cruelle.
Quand il se promenait dans la ville en fin d’après-midi, sa journée de travail terminée, il lui arrivait d’avoir des fantasmes de noyade. Il avait une vision très nette de visages interloqués sur la rive ou sur le pont au-dessus de lui, ou peut-être sur le pont d’un bateau qui passait par là, et puis les eaux se refermaient sur lui et il sombrait doucement, perdant peu à peu la jointure d’un doigt peut-être ou une âme toute recroquevillée, qui gisait alors sur le fond sablonneux, se balançant paisiblement au gré du courant.
Il savait que de telles pensées étaient névrotiques, dangereuses même, mais il n’était pas plus inquiet que cela, estimant qu’il valait mieux les laisser s’exprimer plutôt que d’essayer de les éliminer complètement. Après tout, tout le monde a des fantasmes. La vie est faite d’une multitude de vies. Des vies alternatives. Certaines sont vécues et d’autres imaginées. C’est là toute l’absurdité des biographies, disait-il, des romans. Ils ne prennent jamais en compte les vies alternatives qui projettent leur ombre sur nous tandis que nous cheminons lentement, comme dans un rêve, de la naissance à la maturité et à la mort.
Dans leur ferme aménagée des Black Mountains, sur les hauteurs d’Abergavenny, sa femme – sa seconde femme – servait du vin blanc bien frais aux amis et aux voisins qui passaient les voir, et veillait à ce qu’aucun verre ne reste vide trop longtemps.
Tu pensais à des vies alternatives quand tu montais les escaliers depuis la rue Saint-Julien, disait-elle. Tu y pensais aussi quand tu les descendais.
Les escaliers sont propices aux fantasmes, disait-il. Monter et descendre permet à l’esprit de flotter librement. Nous montons et descendons si souvent les escaliers de notre propre vie, disait-il. Comme nous montons et descendons les gammes sur un piano.
Et toujours avec son chapeau sur la tête, disait sa femme.
Oui, toujours avec mon chapeau sur la tête.
Vous comprenez, disait-il, j’ai mes petites habitudes. Je suis de la vieille génération. Je me serais senti tout nu sans mon chapeau et ma cravate.
Il a dû m’expliquer qu’une suite baroque n’était pas une chambre spacieuse dans un hôtel de luxe, disait-elle, riant à gorge déployée.
Tu avais d’autres qualités, disait-il.
Il ne fait aucun doute qu’elle lui rendait la vie agréable, s’assurant qu’il avait tout ce qu’il voulait et n’était dérangé par aucun des détails de la vie quotidienne. De son côté, il l’admirait, ne faisait rien sans son accord, voulait qu’elle lui dise quand il était fatigué et devait aller se coucher, quand il avait faim et devait manger. Tous leurs amis parlaient du sentiment d’harmonie et de bien-être qui émanait de leur maison dans les collines sur les hauteurs d’Abergavenny.
D’une certaine manière, il avait été heureux, seul dans son petit appartement parisien. Son bureau se trouvait sous la lucarne et quand il travaillait, il sentait le soleil lui réchauffer le haut du crâne et la nuque. Quand il se versait une tasse de thé dans le silence du petit matin, il lui semblait parfois que toute son existence était concentrée dans ce seul événement. Pouvait-on souhaiter plus grand bonheur ?
Et pourtant, disait-il, debout au milieu du grand salon, un verre de vin blanc frais à la main, savons-nous toujours ce que nous ressentons vraiment ?
Il serait injuste de ne pas mentionner, à propos de ce « Cimetière à Barnes », l’exergue bref et sensible, « En souvenir de Bernard Hoepffner, ami cher, traducteur incomparable », qui n’est pas uniquement un hommage sincère à l’interprète français historique, disparu en 2017, des partitions rusées de Gabriel Josipovici. Si la traduction tient presque toujours un rôle au moins métaphorique dans l’œuvre de l’auteur, elle joue ici un rôle direct et absolument central, qui ne tient pas uniquement à la profession du narrateur. Car si c’est « Orfeo » qui est (de loin) le plus cité au fil des pages, c’est pourtant dans le vers en ancien français de Joachim Du Bellay que s’incarnent peut-être le plus profondément, dans cette traduction qui se dérobe, les non-dits qui ont autant, si ce n’est plus, d’importance que les paroles exprimées. Il y a ici comme ailleurs toujours à deviner ce qui est tapi dans le creux de bosses absentes : La Muse ainsi me fait sur ce rivage, / Où je languis banny de ma maison, / Passer l’ennuy de la triste saison / Seule compagne à mon si long voyage.
Lorsqu’il arriva enfin chez lui d’un pas titubant, il était si fatigué qu’il eut du mal à introduire la clé dans la serrure. Il s’affala sur le lit tout habillé et s’endormit immédiatement.
À son réveil, il faisait nuit. Il ne savait pas s’il avait dormi six ou soixante heures. À en juger par sa faim dévorante, c’était probablement soixante. Il trouva de la nourriture dans le frigo et l’engloutit. Puis il enfila péniblement son pyjama et se glissa dans le lit.
Il se réveilla de nouveau au petit matin. Il sortit du lit à tâtons et se dirigea vers la fenêtre pour jeter un coup d’œil au dôme du Panthéon, comme tous les matins. Ce faisant, tendant légèrement le cou vers la gauche comme à son habitude, il se souvint que tout n’avait pas été tout à fait normal au cours des deux derniers jours. Des vies alternatives, se dit-il, puis il prépara son petit déjeuner et s’attela à la traduction du roman qui se trouvait sur son bureau.
Ce ne fut que le soir, alors qu’il prenait son bain, qu’il vit la blessure. C’était une longue incision droite, comme une griffure de chat, qui courait du haut de la cuisse droite jusqu’au genou. Il la toucha délicatement, mais elle n’était pas douloureuse. Il la sécha soigneusement, l’examina de nouveau et décida qu’il n’y avait rien d’autre à faire que de la laisser cicatriser et disparaître. Même si, en réalité, elle ne disparut jamais complètement. Des années plus tard, au Pays de Galles, chaque fois qu’il parlait de ses années parisiennes, il montrait sa jambe et disait en riant : elle n’a jamais guéri.
Tu ne voulais pas qu’elle guérisse, disait sa femme.
Les amis qui le connaissaient de longue date parlaient de la ressemblance entre ses deux épouses. Surtout lorsque sa seconde femme se tenait ainsi au milieu de la pièce et époussetait un disque avant de le lui tendre en disant : en réalité, tu voulais qu’elle ne guérisse pas, non ?
Oui, disait-il en la regardant, accroupi à côté de la platine et attendant qu’elle lui tende le vinyl. C’est ce que je voulais, non ?
Il est tellement superstitieux, disait-elle. Il n’a jamais consulté de médecin à ce sujet.
Qu’est-ce qu’un médecin aurait bien pu faire ?
Peut-être te donner quelque chose pour t’en débarrasser.
Nous avons tous quelque chose comme ça quelque part sur le corps, disait-il. Peut-être que si nous nous en débarrassions, nous ne serions plus nous-mêmes. Qui sait ?
Hugues Charybde, le 28/10/2025
Gabriel Josipovici - Le cimetière à Barnes - Quidam éditions
l’acheter chez Charybde, ici