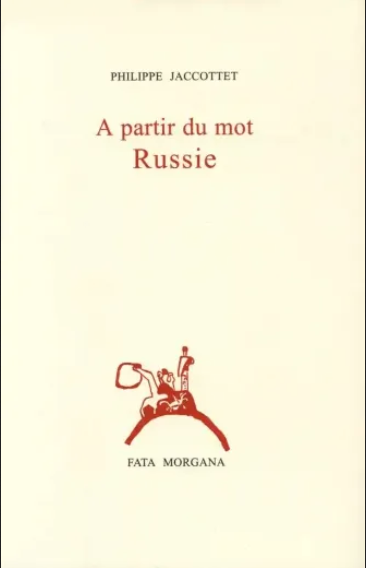Souvenirs de Russie ou bien l'inverse ?
Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un nom géographique ? Philippe Jaccottet explore subtilement ses souvenirs à impact du mot « Russie ».
À ce mot de « Russie » ne sont liées d’abord dans mon esprit que quelques images, tirées de la lecture, enfant, du Michel Strogoff de Jules Verne dans la grande édition Hetzel à couverture rouge et or. Bien sûr, j’avais aimé ce livre, et passionnément, pour son histoire : celle, dramatique et pathétique à souhait, d’une longue lutte entre le bien et le mal, conduite (à une victoire d’emblée prévisible) par un héros aussi noble de cœur, aussi parfait que, dans un autre livre inoubliable, Athos, mon préféré d’entre les mousquetaires (même si me plaisaient aussi le brio de d’Artagnan et la séduction plus sournoise d’Aramis). Mais l’histoire de Michel Strogoff aurait pu se passer, non moins entraînante et convaincante, ailleurs dans le monde ; et ses héros n’avaient, somme toute, pas grand-chose de spécifiquement russe. Non, ce qui, de ce livre, est resté toute ma vie dans mon esprit lié à la Russie, ce ne sont guère que quelques mots et quelques images ; des noms de lieux dont la sonorité rude, brutale même : Omsk, Tomsk, Irkoutsk, suffisait à les rendre étranges et à faire voyager très loin celui qui les entendait, avant même qu’il sût rien d’eux ; des noms de choses, aussi, plus spécifiques : télègue, tarentass, knout ; ce dernier surtout, où le k qui termine tant de noms propres russes claquait en premier comme le coup même du fouet striant le dos ou le visage de la victime, le knout qui s’est alors sans aucun doute gravé en moi comme un des emblèmes de la Russie impériale ; avec ce mot de « czar » dont se sert Jules Verne, tellement plus parlant que « tsar », mieux fait, dans l’éclair de son z, pour évoquer un souverain tout-puissant et lointain, capable du meilleur et du pire ; ce czar dont la personne apparaît pour la première fois dans le livre sous l’apparence, presque effacée, d’un officier de la garde, dans l’éclat des lustres d’un grand bal au Palais Neuf ; mais tournant le dos, lui, à cet éclat, dans la première image du livre, jamais oubliée et légendée ainsi : « Il vint respirer sur un large balcon… » ; personnage d’allure martiale et sévère, bombant le torse sous la tunique à brandebourgs, tandis que l’enfant lecteur découvre plus à gauche, sous le ciel constellé, quelques coupoles d’églises et surtout, aux pieds du souverain, deux cavaliers au galop, figures noires, nerveuses comme des corbeaux, et comme eux annonciateurs, à coup sûr, de malheur…
Pas tout à fait une critique littéraire, l’autre passion du poète et traducteur Philippe Jaccottet, disparu en 2021, mais plutôt une sorte d’essai très personnel, presque autobiographique. Ancré d’abord dans le « Michel Strogoff » de Jules Verne, dont on connaît la puissance littéraire à la limite du paradoxe (Michel Serres la rappelait aussi dans ses « Jouvences sur Jules Verne » de 1974), « À partir du mot Russie », publié en 2002 chez Fata Morgana, réédité en 2022, est immédiatement suivi de deux autres textes, plus classiques de facture, « Dostoïevski, quelques notes en marge » et « Les ténèbres et le froid, voilà l’enfer… ».
C’est Emmanuel Ruben, dans son superbe « Dans les ruines de la carte » de 2015, qui explicitait peut-être le plus en osmose l’attrait littéraire de la cartographie – mais peut-être davantage encore celui des noms sur la carte – à propos de Julien Gracq et, déjà, de Russie. Anthony Poiraudeau, avec son si réussi « Churchill, Manitoba » de 2017, nous en offrait une incontestable démonstration in vivo, fût-elle transportée sur les rivages canadiens de la baie d’Hudson. Philippe Jaccottet, à partir du mot « Russie » précisément, s’inscrit résolument dans cet espace de songe et d’organisation du rêve, où les résonances transcendent les âges de lecture effectifs, où les préjugés d’enfance rejoignent les errances plus adultes, où le savoir revendiqué doit souvent s’effacer devant la seule perception à peine rationnelle – et pourtant si étonnamment productive.
Une immense étendue à l’est du cœur, voilà ce qui s’était ouvert pour la première fois en moi à cette lecture, grâce au pouvoir des noms, des images, grâce aussi à ces cartes qui précisaient l’itinéraire de l’indomptable courrier, comme si l’on ne pouvait pas douter un instant qu’il s’agît d’une histoire réelle. Aujourd’hui, je me dis que cette étendue, que cette réserve d’inconnu aurait pu s’ouvrir, après tout, aussi bien à l’ouest (dans l’Ouest lointain des Peaux-Rouges de Fenimore Cooper), au nord (dans le Grand Nord de Croc-blanc) ou au sud, dans le désert ou la savane d’Afrique. Or, les histoires d’Indiens et de cowboys m’ont laissé presque toujours indifférent, le désert ne me parlait pas encore, toute jungle m’étouffait rien qu’à en entendre le nom, et les récits des régions polaires m’ennuyaient déjà autant que m’est resté encore aujourd’hui presque incompréhensible l’attrait de ces paysages de glace. Il faut donc croire que quelque chose en moi était fait pour se tourner du côté du Levant et l’est encore, même si je me résigne sans trop de peine à ne pas céder à cet attrait au point de vouloir le vérifier sur place, là-bas ; ce là-bas étant d’ailleurs vaste et vague, puisqu’il commence à l’Europe centrale, se prolonge sur les pas de Michel Strogoff et pourrait aller, par le Transsibérien ou par la route des caravanes, jusqu’à la Chine ; mais qu’il s’étend aussi à l’ancienne Perse, au Népal, au Tibet et, moins irrésistiblement, à l’Inde.
Il n’y a pas de grand mystère dans une telle prédilection : pour que ma rêverie s’attache à un lieu, il y faut, outre l’étendue et des réserves de sauvagerie, le souvenir, à défaut de la survivance, d’une haute culture. À l’image de ces cartes géographiques où des couleurs permettent de distinguer au premier coup d’œil déserts, forêts, montagnes et mers, mais aussi bien les zones géologiques ou climatiques, je pourrais dessiner une carte où s’inscriraient la densité, la complexité et le niveau des cultures de l’esprit. Aujourd’hui, je n’ignore pas combien il serait injuste de négliger les cultures de l’Afrique noire ou celle des Aztèques ; comme d’oublier que les Peaux-Rouges, les Esquimaux ont eu eux aussi, un art. Mais la question n’est pas pour moi, en l’occurrence, de tout savoir, ni d’être équitable ; je ne fais que retrouver des lectures, des rêveries, des passions de l’enfance ou de l’adolescence ; de plus, j’en viens à me demander si, pour l’amoureux des livres que j’ai toujours été, était imaginable une culture que l’on n’eût pu recueillir et préserver au fur et à mesure dans ces belles ruches que sont les bibliothèques, avec le foisonnement de leurs milliers de signes, comme autant d’abeilles quelquefois fécondes. Toutes ces écritures, toutes ces belles grandes pages, déchiffrables ou non, comme autant de cartes du ciel, comme des signes entre lesquels transparaîtraient un infini. Il me semble donc bien qu’alors déjà, dans ces lointaines années, consciemment ou non, légitimement ou non, s’étaient alliées dans mon esprit, pour nourrir cet élan confus vers l’Orient, les mêmes deux inclinations qui, plus tard, m’ont attaché à la région où j’habite : le goût des lieux sauvages et celui de la culture, jusqu’à la plus raffinée, et que déjà, sans le savoir, je recherchais leur accord. Avec, de surcroît, la vieille magie de la distance qui perd aujourd’hui de son pouvoir à mesure que toutes les distances se réduisent.
(Il ne faut pas oublier non plus que, pour nous, c’est de ce côté-là que le soleil se lève ; et que les mots orient et origine ont même source.)
Plongeant ensuite en quelques pages moins rêveuses dans ce que Dostoïevski signifia pour lui, à sa découverte puis à sa relecture, Philippe Jaccottet tourne autour d’une éventuelle « âme russe », bien sûr, celle-là même qui fait l’objet en creux, ironique ou tragique, de l’essentiel de l’œuvre contemporaine de Vladimir Sorokine, de l’irruption de la violence dans son « Roman » de 1994 à la synthèse chimique hilarante du « Lard bleu » en 1999, en passant par les consommations outrées et si savoureuses de « Manaraga » (2017) ou par le facétieux et songeur « La tourmente » (2010). Avec un esprit de sérieux que traverse pourtant une ferveur poétique ici plus inattendue, l’auteur des « Paysages avec figures absentes » referme ensuite le couvercle sur ces souvenirs subtilement orientés, en opérant un détour redoutable du côté de la Kolyma et de Varlam Chalamov.
Un pas de côté littéraire dans des souvenirs partagés ou exclusifs qui nous rappelle au passage, à un moment où la tentation est plus grande que jamais, chez certains, d’une fois de plus « jeter le bébé avec l’eau du bain », que la culture ne se réduit pas aux usages politiques et guerriers malintentionnés que l’on peut vouloir en faire à un instant t.
Réflexion faite : qui lit Dostoïevski ne voit pas grand-chose de la Russie ; non seulement presque rien des paysages, de la nature, mais pas grand-chose même des villes, même des intérieurs où l’action se déroule (si l’on songe aux descriptions minutieuses d’un Balzac, par exemple). Il n’a pas l’âme assez tranquille, assez sereine pour s’attarder à cela. Sa fièvre intérieure ne lui en laisse pas le temps. Quand je repense à ses livres, je ne vois guère que de la nuit, de la neige, de la boue, des rues et des escaliers sombres, beaucoup d’escaliers, quelquefois des salons brillants, plus souvent des salles d’auberge enfumées, des bouges, des taudis ; et là-dedans, qui hantent le regard du romancier, des êtres dont les ténèbres intérieures reflètent, redoublent, celles dont ils se dégagent à peine, des visages, à la fois intensément présents et insaisissables, presque toujours surpris en mouvement, sinon en déséquilibre, parce que le sol leur manque sous les pieds. On pourrait penser à Rembrandt, chez qui les visages sont aussi contaminés par les ténèbres (et s’ils sont éclairés, c’est par une lumière qui semble émaner d’eux-mêmes) ; n’était que rien, dans sa peinture, ne rappelle l’instabilité, la violence fiévreuse, l’exaltation parfois frénétique des êtres que portait en lui le romancier.
Ces personnages sont surtout des visages ; surtout des regards ; et beaucoup de paroles, des flots de paroles, souvent hagardes, et que rien ne peut réfréner ; mêlées à beaucoup de larmes, à de plus rares rires, à beaucoup de cris. Dans la vie réelle, on ne supporterait pas longtemps ces forcenés. Pourquoi les a-t-on écoutés, autrefois, plus passionnément que tous les autres, pourquoi les a-t-on aimés à ce point ? Ce pourrait être parce qu’ils crient un peu comme des enfants ou des adolescents, un cri absolument pur (jusque dans l’impureté) ; comme Rimbaud, à qui l’on aura prêté, dans les mêmes années, la même brûlante attention.
Hugues Charybde
Philippe Jacottet - A partir du mot Russie - éditions Fata Morgana